Elles existent partout, à chaque instant, derrière chaque écran : les violences numériques contre les femmes et filles. Harcèlement, menaces, images détournées, humiliations en ligne…
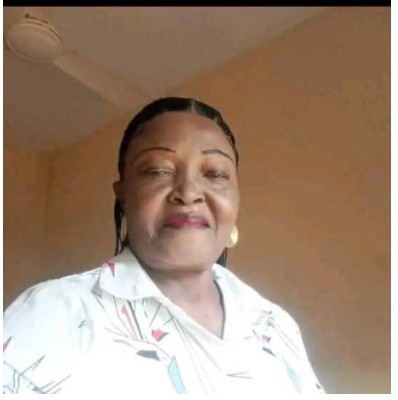
Comment décrivez-vous la situation des violences numériques dans la sous -région ?
La situation est très préoccupante. Les violences numériques, comme le harcèlement en ligne, le Revenge porn, la diffusion non consentie d’images intimes ou les menaces anonymes, touchent un nombre croissant de femmes et de jeunes filles. Nos enquêtes régionales montrent que près de six femmes sur dix ont déjà été confrontées à au moins un incident grave sur les réseaux sociaux. Le pire, c’est que la majorité des victimes n’osent pas en parler, par peur de représailles ou de stigmatisation sociale. Ces violences ne sont pas seulement virtuelles : elles laissent des cicatrices bien réelles.
Beaucoup de femmes nous confient qu’elles ont supprimé leurs comptes ou changé d’identité numérique pour échapper à leurs agresseurs. D’autres subissent des pressions familiales pour « rester discrètes », comme si c’était à elles de se taire. Dans certaines villes, comme Douala ou Kinshasa, le cyberharcèlement a même conduit à des cas de décrochage scolaire ou de démission. La violence numérique est devenue le prolongement invisible des inégalités de genre déjà ancrées dans nos sociétés. Et tant que l’espace numérique restera aussi peu sécurisé, il ne sera jamais un espace d’émancipation pour les femmes africaines.
Quelles sont les causes principales de cette recrudescence ?
Les causes sont multiples et s’entremêlent. D’abord, il y a la démocratisation rapide de l’accès aux smartphones et à Internet, sans accompagnement ni éducation numérique suffisante. Beaucoup de jeunes découvrent les réseaux sociaux sans en comprendre les risques, ni les règles éthiques. Ensuite, la culture du patriarcat persiste jusque dans le monde virtuel : certains hommes considèrent qu’une femme qui s’exprime librement en ligne « provoque » ou « s’expose ». Cette mentalité alimente un climat d’impunité.
À cela s’ajoute l’absence de cadre légal solide : dans de nombreux pays d’Afrique centrale, les lois sur la cybercriminalité datent d’avant l’essor des réseaux sociaux. Résultat : les plaintes liées au cyberharcèlement ou à la diffusion d’images intimes sont rarement prises au sérieux. Enfin, les plateformes numériques elles-mêmes jouent un rôle : leurs algorithmes, souvent aveugles au contexte local, laissent circuler insultes, humiliations et fausses informations ciblant les femmes. Tant que la régulation et l’éducation numérique ne progresseront pas ensemble, la violence continuera de prospérer.
Quels types de conséquences ces violences ont-elles sur les victimes ?
Les conséquences sont profondes, à la fois psychologiques, sociales et économiques. Psychologiquement, les victimes développent de l’anxiété, une perte d’estime de soi, parfois même des troubles du sommeil ou un isolement social extrême. Certaines tombent en dépression ou développent une peur panique d’être filmées ou photographiées. Nous avons documenté des cas de jeunes filles qui ont quitté l’école à cause de rumeurs lancées sur WhatsApp.
Socialement, ces violences brisent des vies : des fiancées répudiées, des élèves humiliées publiquement, des femmes licenciées à cause de montages compromettants. Dans la sphère professionnelle, les répercussions sont dramatiques : une simple vidéo truquée peut anéantir une carrière. Et tout cela se déroule dans un contexte où le soutien psychologique est quasi inexistant. Une femme victime doit souvent affronter seule la honte, le silence et l’inaction des autorités. Ce cumul de blessures invisibles crée une fracture numérique entre hommes et femmes : beaucoup renoncent à s’exprimer en ligne, privant ainsi nos sociétés de voix féminines essentielles.
Comment les institutions répondent-elles à ce fléau?
Les institutions peinent encore à suivre. Les forces de l’ordre manquent cruellement de formation sur les crimes numériques : il n’est pas rare qu’une plainte pour harcèlement en ligne soit classée sans suite faute de preuves « tangibles ». Certaines victimes se voient même reprocher leur « imprudence ». Les tribunaux, eux, sont débordés et ne disposent pas toujours d’outils techniques adaptés pour identifier les auteurs derrière des pseudonymes.
Cependant, quelques progrès méritent d’être salués : le Cameroun, le Congo et le Tchad ont récemment engagé des réformes de leurs codes pénaux pour inclure la notion de violence numérique basée sur le genre. Des formations commencent à émerger dans les écoles de magistrature et de police. Mais, comme le souligne souvent Me Fato, « sans volonté politique claire ni ressources dédiées, ces textes resteront symboliques ». Ce qu’il faut désormais, c’est un plan d’action régional coordonné, car Internet n’a pas de frontières : un agresseur au Gabon peut nuire à une victime au Cameroun.
Quelles initiatives locales montrent que le problème peut être combattu ?
Il existe des signaux encourageants. Plusieurs ONG et associations de jeunes femmes se sont emparées du sujet. Par exemple, le collectif « CyberSafe Girls » forme des lycéennes à sécuriser leurs comptes et à détecter les comportements abusifs. Au Congo, une plateforme citoyenne baptisée #StopHaineEnLigne offre un espace d’écoute et de médiation. Dans les zones rurales, des radios communautaires diffusent des messages en langues locales sur la sécurité numérique.
Ces initiatives restent fragiles, souvent dépendantes de financements extérieurs, mais elles prouvent qu’une mobilisation citoyenne peut renverser la tendance. Des partenariats public-privé commencent à voir le jour pour former enseignants et parents. Ce qu’il manque encore, c’est la coordination : relier ces efforts isolés pour créer un véritable réseau régional de prévention et de prise en charge. La société civile a ouvert la voie ; aux États maintenant de suivre.
Le secteur privé peut-il jouer un rôle ?
Bien sûr, et un rôle majeur. Les entreprises technologiques doivent assumer leur part de responsabilité. Trop souvent, les contenus violents envers les femmes circulent librement sans modération. Les géants du numérique, tout comme les opérateurs télécoms locaux, peuvent être des alliés puissants s’ils mettent en place des mécanismes de signalement plus rapides et des campagnes d’éducation numérique.
Comme on le dit : « Quand une plateforme supprime une publication haineuse en moins d’une heure, c’est une vie protégée. » Les start-ups africaines ont également leur mot à dire : certaines développent des outils d’alerte automatique ou de soutien psychologique virtuel. Nous devons encourager cette innovation éthique locale. L’avenir d’un cyberespace sûr passera autant par la technologie que par l’éducation.
Quelle est votre vision pour un cyberespace sûr en Afrique centrale ?
Je rêve d’un espace numérique inclusif où chaque femme, qu’elle soit étudiante, journaliste ou commerçante, puisse s’exprimer sans crainte d’être humiliée. Cela demande une transformation culturelle autant que technique. Les États doivent moderniser leurs lois, les écoles intégrer la citoyenneté numérique dans les programmes, et les familles briser le tabou du silence.
Ma vision, c’est celle d’un Internet africain qui protège et élève plutôt qu’il ne détruit. Nous devons bâtir une éthique numérique panafricaine, fondée sur le respect, la responsabilité et la solidarité. Chaque pays gagnerait à adopter une charte régionale contre la violence numérique de genre, assortie de sanctions réelles. L’avenir de nos filles se joue aussi dans leurs écrans.
Un dernier message pour conclure ?
La violence numérique n’est pas une fatalité : c’est un phénomène social que nous pouvons transformer. Il faut cesser de la minimiser. Quand une femme est humiliée en ligne, c’est toute une société qui perd un peu de sa dignité. J’en appelle à la mobilisation collective : enseignants, influenceurs, parents, politiques, chacun a un rôle à jouer. Ces 16 jours d’activisme ne doivent pas être une parenthèse symbolique, mais un déclencheur d’action permanente.
Chaque partage responsable, chaque signalement d’abus, chaque mot de soutien est un acte de résistance. L’Afrique centrale a déjà prouvé sa capacité à se lever contre l’injustice ; il est temps de la voir se lever aussi pour la dignité numérique des femmes et des filles.
Propos recueillis par JRMA