Pour le Tchadien, internationaliste et ancien consultant du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), la feuille de route du président Denis Sassou Nguesso devrait incarner une véritable rupture.
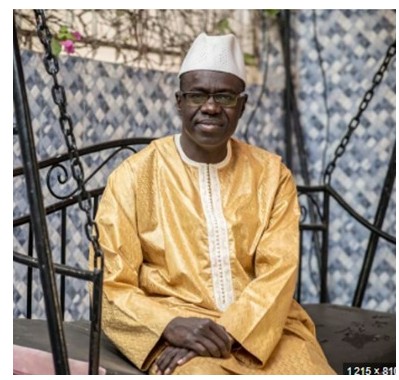
Merci de vous exprimer dans les colonnes d’Intégration. La déclaration de Denis Sassou Nguesso à Bangui le 10 septembre 2025, annonçant la mise en place d’un mécanisme concret pour faciliter la libre circulation des personnes et des biens au sein de la CEMAC, a fait beaucoup de bruit. Quelle est votre première analyse sur cette annonce ?
Merci à vous. À première vue, cette déclaration est un signal fort en faveur de l’intégration régionale. La libre circulation est un pilier fondamental de la CEMAC. Son absence effective a longtemps freiné le commerce intra-régional, la mobilité professionnelle et les investissements. Sur le plan symbolique, le fait que Sassou Nguesso choisisse Bangui — capitale d’un pays périphérique mais stratégique dans la zone — montre son intention de replacer la libre circulation au cœur de l’agenda communautaire.
Cependant, il faut rappeler que ce n’est pas la première fois que la CEMAC annonce des mesures dans ce sens. Depuis sa création en 1994, plusieurs initiatives ont été mises sur la table : le passeport communautaire, la réduction progressive des barrières douanières et l’harmonisation des taxes. Dans la pratique, ces initiatives ont souvent été freinées par des divergences politiques entre États membres et par la faiblesse des infrastructures. Certains pays ont continué à privilégier la protection de leurs marchés locaux, ce qui a créé des disparités et limité l’effet réel de ces politiques. L’annonce de Sassou Nguesso peut donc être vue comme une tentative de revitaliser un processus longtemps stagnant, mais la question clé demeure : verra-t-on des résultats tangibles sur le terrain ?
Pensez-vous que cette déclaration puisse se traduire en mesures concrètes à court terme ?
C’est exactement à ce niveau que se situe le défi. Pour que cette déclaration dépasse le symbole, elle doit s’accompagner de mesures opérationnelles claires et suivies. Historiquement, sous les précédents mandats de Sassou Nguesso à la tête de la CEMAC, plusieurs initiatives similaires avaient été annoncées, mais leur mise en œuvre a souvent été limitée. Les obstacles n’étaient pas seulement administratifs, mais aussi politiques : la coordination entre États membres est complexe, et la volonté réelle des gouvernements de réduire leurs barrières nationales reste variable.
À court terme, plusieurs conditions doivent être réunies : premièrement, un accord clair sur les règles de circulation et les documents exigés pour les personnes et les biens. Deuxièmement, la simplification des procédures douanières et migratoires, encore aujourd’hui un frein majeur. Troisièmement, la communication auprès de la population et des acteurs économiques, afin qu’ils comprennent leurs droits et obligations. Sans ces éléments, le mécanisme risque de rester théorique. Enfin, un suivi indépendant, capable d’identifier les blocages et de proposer des ajustements, sera essentiel pour transformer cette déclaration en action concrète.
Quels obstacles concrets voyez-vous à la mise en place de ce mécanisme ?
Les obstacles sont multiples. Sur le plan juridique, chaque État membre possède ses propres réglementations, souvent contradictoires avec les directives communautaires. Harmoniser ces règles demandera du temps et une volonté politique forte. Sur le plan sécuritaire, certains pays craignent que la libre circulation facilite la criminalité transfrontalière, notamment le trafic de biens et les déplacements irréguliers. Enfin, les infrastructures restent un défi majeur : routes inadéquates, postes frontaliers sous-équipés, systèmes informatiques obsolètes. Si ces aspects ne sont pas traités simultanément, la libre circulation restera un idéal difficile à atteindre.
Qu’en est-il de l’impact pour les entreprises et les citoyens ?
L’impact pourrait être significatif si le mécanisme est réellement opérationnel. Les entreprises bénéficieraient d’une réduction des coûts logistiques, d’une meilleure planification des exportations et d’une intégration plus fluide dans un marché régional plus vaste. Pour les citoyens, cela pourrait faciliter les déplacements pour le travail, le commerce ou les études, et renforcer le sentiment d’appartenance à une communauté régionale. Mais pour que ces bénéfices se concrétisent, il faudra que les procédures soient simples, rapides et fiables. Sans cela, le mécanisme risque de créer plus de confusion que d’avantages.
Selon vous, quelles seraient les étapes clés pour réussir cette initiative ?
Plusieurs étapes sont cruciales. D’abord, harmoniser les réglementations douanières et migratoires des États membres. Ensuite, moderniser les infrastructures frontalières et digitaliser les contrôles pour réduire les délais et la corruption. Parallèlement, il faudra sensibiliser la population et les acteurs économiques aux nouvelles procédures. Enfin, un dispositif de suivi indépendant permettra d’évaluer les progrès et de corriger les obstacles en temps réel. Ces étapes, si elles sont suivies de manière rigoureuse, pourraient transformer cette initiative en véritable succès pour l’intégration régionale.
Certains observateurs rappellent le passif de Sassou Nguesso sur ces questions. Comment analysez-vous ce point ?
Ce passif existe, c’est vrai. Lors de ses précédents mandats, plusieurs initiatives ambitieuses avaient été lancées pour la libre circulation, mais elles ont été partiellement mises en œuvre. Les intentions étaient souvent louables, mais la complexité politique et technique a limité leur efficacité. Il ne s’agit pas d’un échec volontaire, mais d’un manque de préparation face aux obstacles réels. Aujourd’hui, les attentes sont plus fortes, et la pression économique et sociale sur la région pourrait créer un contexte plus favorable pour des actions concrètes.
Comment évaluez-vous le symbolisme politique de cette déclaration pour la CEMAC ?
Le symbole est fort. Sassou Nguesso envoie un message politique : la CEMAC peut et doit relancer l’intégration régionale. Cela renforce sa légitimité en tant que leader capable de proposer des solutions concrètes aux défis économiques et sociaux. Mais il faut rester prudent : les paroles doivent être suivies d’actions concrètes pour avoir un impact réel sur le quotidien des populations.
En conclusion, peut-on parler d’un tournant pour l’intégration régionale?
Potentiellement, oui, mais avec prudence. Les paroles du président Sassou Nguesso sont encourageantes et montrent une volonté politique de relancer l’intégration. Cependant, la CEMAC a trop souvent connu des promesses non tenues pour ne pas rester vigilants. Le véritable test sera la capacité des États membres à transformer ces paroles en mesures concrètes, efficaces et durables. Si cela se produit, nous pourrions assister à une avancée significative vers une intégration réelle. Sinon, il s’agira d’un énième épisode de rhétorique symbolique, sans impact tangible sur le quotidien des populations et des entreprises.
Propos rassemblés par
Jean-René Meva’a Amougou





