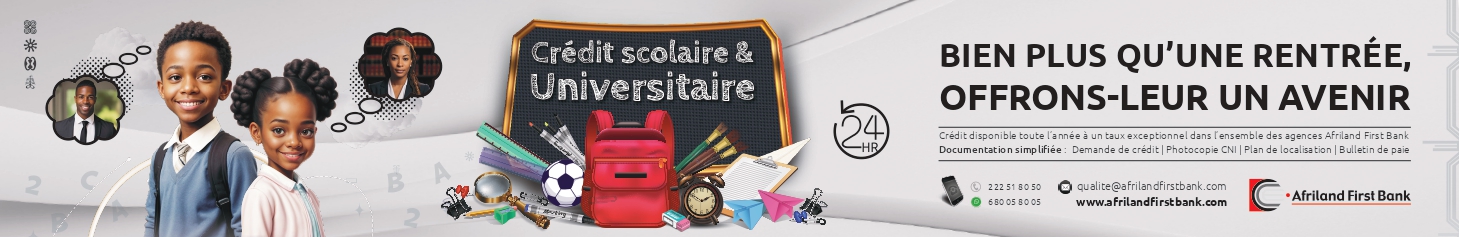Non Achille non Mbembe ce tamtam sonne creux!

Introduction : Le contexte et l’enjeu
À l’approche de l’élection présidentielle du 12 octobre 2025 au Cameroun, le philosophe et essayiste Achille Mbembe a tenu des propos qui ont suscité de vives réactions dans les cercles intellectuels et citoyens. Invité sur les ondes de RFI, il a affirmé qu’il fallait « s’attaquer à la question du tribalisme et en finir avec la fixation contre les Bamilékés ». Cette déclaration, faite dans un contexte marqué par l’éviction de l’opposant Maurice Kamto et la candidature controversée du président Paul Biya pour un huitième mandat, s’inscrit dans une analyse plus large de la crise démocratique que traverse le pays.
Si la dénonciation du tribalisme comme poison politique est légitime, la formulation choisie par Mbembe — celle d’une « fixation » contre une communauté précise — appelle à être interrogée. Car derrière cette expression se dessine une lecture du Cameroun qui risque de reconduire les schémas simplistes et ethnicisés que de nombreux chercheurs africanistes et ou africains ont précisément tenté de dépasser. En tant que socio-politologue ayant travaillé sur le terrain camerounais, je propose ici une lecture alternative, fondée sur les réalités institutionnelles, historiques et sociales du pays. Il ne s’agit pas de nier les tensions, mais de refuser leur réduction à des oppositions tribales figées, et de réinscrire le débat dans une perspective politique plus large, plus juste et plus féconde.
Une pluralité qui rend la haine homogène impossible
Parler de « fixation » contre les Bamilékés, comme le fait Achille Mbembe, revient à suggérer l’existence d’une obsession collective, d’un ressentiment partagé à l’échelle nationale. Or, cette hypothèse ne résiste pas à l’épreuve de la réalité sociologique du Cameroun. Avec ses 256 tribus, ses langues multiples, ses traditions diverses, le Cameroun est tout sauf un bloc homogène. Il est une mosaïque vivante, un archipel de peuples qui coexistent, s’interpénètrent, parfois s’opposent, mais jamais ne se fondent dans une haine univoque.
La pluralité camerounaise est une donnée historique et anthropologique irréductible. Elle rend impossible l’idée d’une coalition implicite ou explicite de toutes les autres communautés contre une seule. Une telle lecture relève davantage du mythe politique que de l’analyse rigoureuse. Elle ignore les dynamiques locales, les alliances transversales, les solidarités économiques et les circulations culturelles qui traversent le pays.
En somme, la complexité du Cameroun interdit toute simplification ethnique. Et c’est précisément cette complexité qu’il faut préserver, penser, et inscrire au cœur du projet national — non la réduire à des antagonismes figés qui servent trop souvent de prétexte à l’immobilisme politique.
Déconstruction du schéma ethno-conflictuel
L’un des travers les plus persistants dans l’analyse des conflits africains est la projection de grilles de lecture européo-centristes, qui réduisent la complexité des sociétés africaines à des oppositions binaires : Nord musulman contre Sud chrétien, ethnies en guerre perpétuelle, tribus irréconciliables. Ces schémas, largement relayés par les médias internationaux et parfois repris par des intellectuels africains eux-mêmes, ne rendent pas compte des dynamiques locales, historiques, religieuses, économiques et politiques qui structurent les réalités du continent.
Dans le cas du Cameroun, cette lecture est particulièrement problématique. Elle ignore les logiques de cohabitation, de négociation et de solidarité qui traversent les communautés. Elle passe sous silence les alliances transversales, les réseaux économiques interethniques, et les formes d’organisation sociale qui échappent aux catégories figées. Elle transforme des tensions conjoncturelles en antagonismes ontologiques, et des stratégies de pouvoir en fatalités culturelles.
Il faut le dire clairement : le tribalisme n’est pas une essence africaine. C’est une stratégie politique, souvent activée pour neutraliser les oppositions, diviser les masses, et conserver le pouvoir. Il est instrumentalisé par des élites qui, incapables de construire un projet national inclusif, préfèrent fragmenter le corps social pour mieux le contrôler. Cette instrumentalisation du tribalisme est documentée dans plusieurs contextes africains, du Congo-Brazzaville à la Côte d’Ivoire, où les appartenances ethniques ont été mobilisées pour justifier des violences politiques.
Ainsi, réduire la crise camerounaise à une haine ethnique contre les Bamilékés revient à reconduire ces schémas simplistes, à ignorer les causes structurelles du malaise national, et à détourner l’attention des véritables enjeux : la caporalisation des institutions, la confiscation du pouvoir, et la paupérisation organisée du peuple.
Appui sur les traditions intellectuelles camerounaises
Face aux lectures réductrices du politique camerounais, il est essentiel de se tourner vers les traditions intellectuelles qui ont pensé le pays dans sa profondeur historique, sa complexité institutionnelle et sa vocation plurielle. Les travaux d’Adalbert Owona, Engelbert Mveng et Louis-Paul Ngongo constituent à cet égard des repères majeurs. Ils ne se sont jamais contentés d’expliquer le Cameroun par des antagonismes ethniques : ils ont cherché à comprendre les dynamiques de pouvoir, les logiques de construction nationale, et les fondements culturels de la citoyenneté.
- Adalbert Owona, historien rigoureux, a exploré les trajectoires politiques du Cameroun à travers les archives coloniales et postcoloniales, mettant en lumière les continuités institutionnelles et les ruptures idéologiques. Il a montré que les conflits ne naissent pas des identités, mais des usages politiques qui en sont faits.
- Engelbert Mveng, prêtre jésuite, historien, théologien et artiste, a proposé une pensée de l’Afrique enracinée dans sa spiritualité et sa mémoire. Il a défendu l’idée d’un christianisme africain authentique, capable de dialoguer avec les traditions locales sans se renier. Pour Mveng, le Cameroun ne peut être pensé sans sa profondeur culturelle, sans sa quête de souveraineté, sans sa volonté d’incarner une justice fondée sur la dignité humaine.
- Louis-Paul Ngongo, politologue, a travaillé sur l’histoire des institutions politiques au Cameroun, en montrant comment les structures étatiques ont été façonnées par des logiques de centralisation, de contrôle et de fragmentation. Il a insisté sur la nécessité de refonder l’État à partir des réalités locales, des pratiques citoyennes, et des aspirations démocratiques.
Ces penseurs ont en commun une conviction : le Cameroun est une nation en devenir, fondée non sur l’addition de rancunes ethniques, mais sur la négociation, la mémoire et la justice. Ils nous invitent à refuser les lectures simplistes, à déconstruire les récits de haine, et à penser le politique comme un espace de construction collective.
La résilience bamiléké comme contre-argument
L’idée d’une haine atavique contre les Bamilékés, telle que formulée par Achille Mbembe, ne résiste pas à l’analyse des faits. Car si cette communauté était réellement l’objet d’une hostilité généralisée, comment expliquer sa présence active et structurante dans tous les secteurs de la société camerounaise — de l’économie à la culture, en passant par la sphère politique ?
Sur le plan économique, les Bamilékés sont reconnus pour leur esprit entrepreneurial, leur capacité à bâtir des réseaux commerciaux solides, et leur contribution significative au tissu productif national. Des marchés urbains aux entreprises rurales, leur empreinte est visible, durable, et souvent exemplaire. Cette vitalité économique est le fruit d’une culture de travail, de solidarité familiale et communautaire, et d’une résilience historique face aux exclusions et aux crises.
Sur le plan culturel, ils ont su préserver et valoriser leurs traditions tout en participant activement à la modernité camerounaise. Leurs pratiques artistiques, leurs rites, leur langue et leur patrimoine oral enrichissent le paysage culturel du pays. Ils sont aussi présents dans les médias, la musique, la littérature, et les arts visuels, contribuant à façonner une identité nationale plurielle.
Sur le plan politique, malgré les tentatives de marginalisation, les Bamilékés ont toujours été engagés dans les luttes démocratiques, depuis l’époque de l’Union des Populations du Cameroun jusqu’aux mouvements contemporains. Leur participation à la vie publique, leur présence dans les partis politiques, les institutions et les débats nationaux témoigne d’une volonté constante de contribuer à la construction du Cameroun. Sans vouloir le dire, les leurs sont aussi bien enracinés dans la minorité qui confisque le pouvoir politique au Cameroun.
Cette résilience n’est pas le signe d’une victimisation, mais d’une capacité à transformer l’adversité en force collective. Elle repose sur une mémoire historique douloureuse — celle des répressions post-indépendance, des stigmatisations et des exclusions — mais elle ne s’y enferme pas. Elle s’enracine dans une dynamique communautaire, éducative et spirituelle qui permet à la communauté bamiléké de se reconstruire, de se projeter et de participer pleinement à la vie nationale.
En somme, si les Bamilékés étaient réellement l’objet d’une haine atavique, comment expliquer leur vitalité dans tous les secteurs de la société camerounaise ? Cette question, loin d’être rhétorique, invite à repenser les termes du débat : non en termes de persécution figée, mais en termes de résilience active, de présence féconde, et de contribution nationale.
Proposition d’une lecture alternative
Face aux tentations de simplification ethnique, il est urgent de proposer une lecture plus rigoureuse, plus enracinée, et surtout plus fidèle aux réalités du Cameroun. Réduire les tensions politiques à des haines tribales, c’est ignorer les mécanismes profonds qui structurent la crise nationale : la caporalisation des institutions, la confiscation du pouvoir, et la pauvreté organisée.
La caporalisation des institutions se manifeste par une centralisation excessive du pouvoir, une instrumentalisation des organes de l’État, et une mise au pas des contre-pouvoirs. Les institutions, au lieu d’être des espaces de régulation démocratique, deviennent des prolongements du pouvoir exécutif, incapables de garantir l’équité, la transparence ou la justice sociale.
La confiscation du pouvoir, quant à elle, repose sur une logique de verrouillage politique : exclusion des opposants, manipulation des processus électoraux, et maintien d’un ordre autoritaire sous couvert de légalité. Le cas de Maurice Kamto, écarté du processus électoral, en est une illustration frappante tout comme ma propre exclusion alors même que je présentais un dossier complet à Election’s Cameroon. Ce verrouillage empêche l’émergence d’une véritable alternative politique et entretient une culture de résignation.
Enfin, la pauvreté organisée est le résultat d’une gouvernance qui transforme les politiques publiques en instruments de dépendance. L’accès aux ressources, aux soins, à l’éducation ou à l’emploi est conditionné par des logiques clientélistes, où les citoyens sont sommés de faire preuve d’allégeance pour bénéficier de ce qui devrait être des droits. Cette pauvreté n’est pas accidentelle : elle est structurée, entretenue, et utilisée comme levier de contrôle.
Dans ce contexte, le tribalisme n’est pas la cause, mais le symptôme. Il est activé pour détourner l’attention, fragmenter les revendications, et empêcher la construction d’un front citoyen uni. C’est pourquoi il faut refuser les lectures identitaires et proposer une refondation du pacte national — une refondation qui reconnaisse la pluralité du Cameroun, valorise ses diversités, et construise une communauté politique fondée sur la justice, la mémoire et la responsabilité partagée.
Dieudonné Essomba