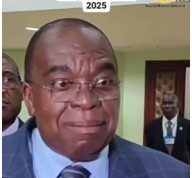Fin du suspense pour les candidats au Baccalauréat de l’enseignement secondaire général (BESG)… du moins pour ceux qui n’iront pas solliciter un réexamen de leurs notes à l’Office du baccalauréat du Cameroun (OBC). Selon cette institution, le cru 2025 affiche un taux de réussite de 47,4 %, soit une amélioration de 10% par rapport à la session 2024 (37,2 %). Et la République se félicite de compter chaque année toujours plus de nouveaux bacheliers.

En 1970, un peu moins de 20 % des Camerounais étaient titulaires du baccalauréat. Un demi-siècle plus tard, le Cameroun a radicalement changé : près de 80 % des jeunes décrochent aujourd’hui ce diplôme. Une hausse moins due à un progrès réel du niveau qu’à l’évolution des modalités de correction et à l’allègement des exigences. Peut-on sérieusement postuler que les élèves actuels se sont courageusement hissés à un niveau que leurs prédécesseurs n’atteignaient pas ? Peut-on croire que les professeurs ont déployé des trésors de pédagogie pour réussir un tel exploit ?
Et c’est là tout le paradoxe : jamais une génération n’a été aussi diplômée du baccalauréat, et pourtant, jamais le constat d’une baisse générale du niveau scolaire n’a été aussi largement partagé. Le baccalauréat, jadis sésame prestigieux, est devenu un rite de passage quasi automatique, au point que la sélectivité en a été dramatiquement affaiblie par « l’eau » qui, dit-on, coule à flot. Comment en sommes-nous arrivés là ? Sans doute par aveuglement idéologique. Une idée reçue, devenue quasi dogme, voulait que l’on puisse élever le niveau global des élèves français en envoyant toujours plus de jeunes vers le supérieur, sans distinction, sans sélection, sans orientation adaptée. Rien n’était plus faux. En abaissant sans cesse les exigences du diplôme, on a simplement déplacé la frontière de la sélection sociale. Comme l’ont analysé quelques enseignants, l’école contribue, sous couvert de démocratisation, à la reproduction des inégalités sociales.
Pendant ce temps, l’université, devenue un vaste entonnoir, peine à jouer son rôle d’ascenseur social. Au lieu de garantir l’émancipation des classes populaires, elle s’est vidée de son autorité et de son prestige. Elle est devenue, pour beaucoup, un purgatoire où s’accumulent désillusions et échecs, faute d’un accompagnement adapté et d’un niveau d’exigence homogène. Le Cameroun a donc réussi ce tour de force paradoxal : massifier l’accès aux études supérieures tout en préservant, voire renforçant, les logiques de reproduction sociale. Résultat : baisse du niveau général et blocage de l’ascenseur social. Force est de constater que ce modèle n’a pas fonctionné. Il faut avoir le courage de rompre avec cette illusion de la massification.
Une vraie politique de méritocratie consisterait d’abord à restaurer le baccalauréat dans sa valeur sélective, en assumant qu’il doit sanctionner un niveau réel de connaissances et de compétences. Ensuite, il faudrait cesser d’envoyer indistinctement tous les bacheliers vers l’université. L’orientation doit devenir plus précoce, plus fine, plus réaliste. Il ne s’agit pas de dresser des murs infranchissables, mais de redonner du sens aux diplômes, de l’exigence à l’enseignement, et de la sincérité aux statistiques.
L’excellence doit redevenir un horizon accessible à tous, à condition d’y mettre le travail, l’effort et le mérite, au lieu d’être celle qui n’ouvre plus aucune porte et qui laisse tant de jeunes naufragés sur les rives de l’université. Il est temps d’admettre que la véritable égalité n’est pas celle des diplômes distribués à tous, mais celle des chances offertes à chacun d’atteindre l’excellence.
Bobo Ousmanou