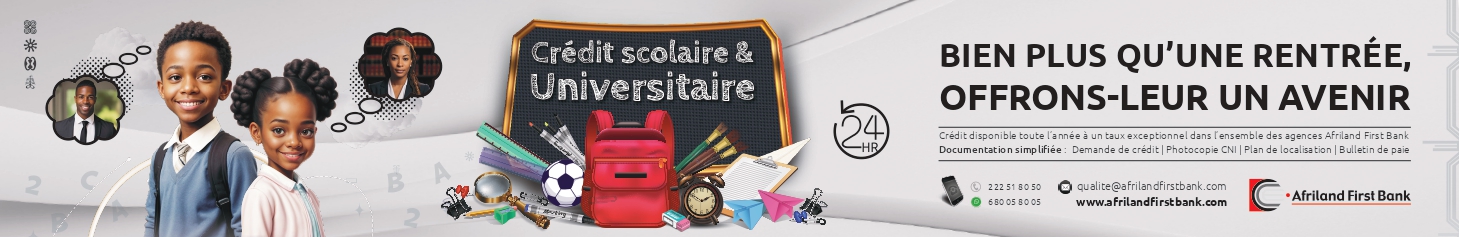Entre heurs et malheurs ; entre ombres et lumières. Pour relever le défi qu’impose ce tableau, il faut, selon Pr Jean-François Akandji-Kombé, renverser la table en adossant la croissance à la libre circulation des personnes et des marchandises, accroître la force des impératifs juridiques, juridictionnels, socio-économiques et s’appuyer sur une volonté et un engagement politiques forts.
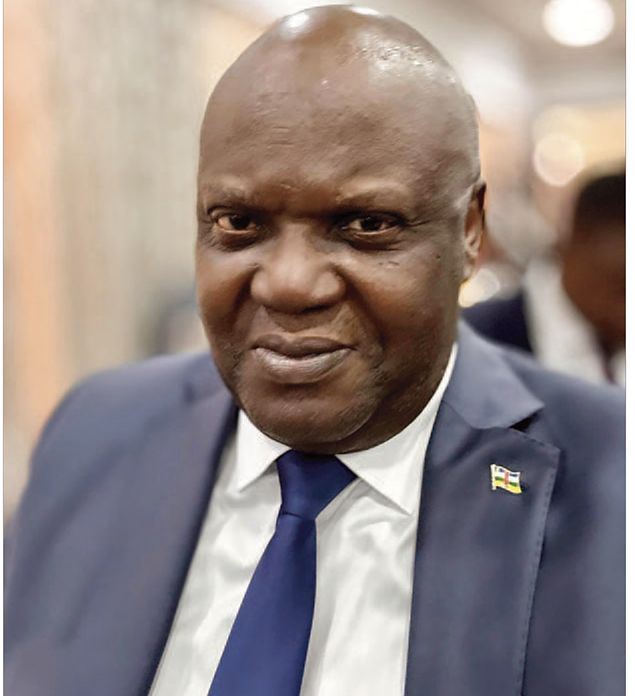
«Enjeux de la libre circulation des personnes dans l’espace Cemac : droits fondamentaux, citoyenneté et croissance économique». Jamais auparavant un citoyen congolais n’avait entendu cela. Depuis Brazzaville où il suit la conférence du Pr Jean-François Akandji-Kombé, l’homme se demande s’il s’agit pour l’orateur d’« élever autrement le thème de la 16e édition de la Journée Cemac ». Au total, la courte séquence donne le ton de la dimension savante du programme (« The Coffee of Integration») proposé ce 21 mars 2025 par la Société africaine de droit communautaire.
Fondements bancals
Pour rendre son propos accessible, Pr Jean-François Akandji-Kombé présente en préambule ce qu’il faut retenir comme éléments caractérisant la libre circulation des personnes dans l’espace Cemac : « Elle est tardive et suspicieuse ». Pour le Centrafricain, Professeur à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, pas besoin de contourner : « Bien que l’idée d’intégration régionale ait été très tôt lancée en Afrique centrale, on constate qu’elle s’y est enracinée très difficilement parce qu’elle n’était pas bienvenue à la fois par les Etats et les institutions de la Cemac ». Il explique : « Le désaccord constaté entre les Etats de la zone Cemac au sujet de la question de la libre circulation des personnes trouve ses fondements dans un faisceau de facteurs éminemment subjectifs. Ici, la subjectivité tient au fait que les raisons de la discorde renvoient à des constructions imaginaires plus ou moins entretenues par les pouvoirs politiques locaux, particulièrement au Gabon et en Guinée équatoriale. Trois mythes tenaces paraissent sous-tendre la forte réticence de ces deux Etats à ouvrir largement leurs frontières aux flux migratoires étrangers, qu’ils soient intracommunautaires ou non, de même que l’attitude ouvertement xénophobe de leurs populations respectives à l’égard des frères de la sous-région ».
La suite qu’étale Pr Jean-François Akandji-Kombé en dit long sur le complexe d’infériorité par le nombre que paraissent nourrir le Gabon et la Guinée équatoriale, les deux Etats démographiquement les plus faibles de la Cemac. « Un fait tend à attester ce complexe : le gonflement des statistiques démographiques officielles. Généralement interprétée comme un moyen de justifier aux yeux des bailleurs de fonds et organismes multilatéraux les dépenses par trop excessives des gouvernants, ainsi que leur incapacité à redistribuer équitablement les richesses nationales, cette pratique du surplus démographique peut être aussi perçue comme un alibi géopolitique. Précisément, l’augmentation artificielle du nombre des étrangers, constatée particulièrement en Guinée équatoriale, permet d’accréditer la célèbre thèse de l’invasion démographique d’origine étrangère et donc, in fine, de justifier le maintien par cette nation numériquement défavorisée d’une clause migratoire particulière, autrement dit la pratique d’expulsions massives d’immigrés ».
À l’analyse du droit en vigueur en Afrique centrale, les textes suprêmes de l’ordre juridique qui ont consacré le principe de la libre circulation des personnes sont de deux ordres : les textes communautaires et certaines constitutions des États membres ». Pr Jean-François Akandji-Kombé les énumère longuement : « Il est important de relever que la consécration de la libre circulation des personnes au sein de la Cemac a connu plusieurs étapes. À chaque étape, différents textes ont été adoptés. À ce sujet, on peut citer, entre autres, l’accord de coopération en matière de police criminelle entre les États de l’Afrique centrale du 29 avril 1999 ; le règlement n° 1/100 -Cemac-042-CM-04 du 21 juillet 2000 portant institution et conditions d’attribution du passeport Cemac ; l’accord de coopération Interpol-Cemac du 29 mars 2001 ; l’accord de coopération judiciaire entre les États de la Cemac du 28 janvier 2004 ; l’Acte additionnel n° 08/Cemac-CEE-SE du 29 juin 2005 relatif à la libre circulation des personnes en zone CEMAC ; la décision n° 02/08-UEAC-CM-17 du 20 juin 2008 portant liste des personnes admises à titre transitoire à circuler sans visa en zone Cemac ; le règlement n° 01/08-UEAC-042-CM-17 du 16 mars 2010 portant institution et conditions de gestion et de délivrance du passeport Cemac ; la décision n° 2/11 UEAC 070 U-CM-22 du 19 décembre 2011 portant extension de l’accès aux services d’Interpol I 24/7 ; l’Acte additionnel n° 01/13-Cemac-070 U-CCE S.E du 25 juin 2013 portant suppression du visa pour tous les ressortissants de la Cemac circulant dans l’espace communautaire. Cet acte additionnel est annexé au traité de la Cemac et complète celui-ci sans le modifier. Son respect s’impose aux organes et institutions spécialisés de la Communauté ainsi qu’aux autorités des États membres».
Qui est citoyen de la Cemac ?
Sur le plan communautaire, affirme Pr Jean-François Akandji-Kombé, «l’un des droits conférés par la citoyenneté est la libre circulation. Ainsi, citoyenneté et libre circulation des personnes entretiennent des rapports étroits, l’une permettant la consolidation de l’autre. En d’autres termes, la reconnaissance de la liberté de circulation des personnes est un principe fondateur de la citoyenneté dans un cadre bien défini ». Ainsi, à la faveur de la libre circulation, il s’agit de favoriser l’éclosion d’une citoyenneté Cemac qui est en réalité l’instrument d’une solidarité plus étroite entre les peuples de la sous-région. Dès lors, on peut constater que la citoyenneté s’exerce essentiellement dans le cadre des droits de l’homme, car le fait d’être un citoyen qui bénéficie de certains droits et libertés renforce la protection de l’individu. « Il existe donc pour les citoyens un lien entre l’appartenance à la Cemac et la protection des droits de l’homme. Sous cet angle, on trouve certaines similitudes car la citoyenneté au sein de la Cemac ressemble en partie à la citoyenneté de type classique. Dans cette Communauté, la citoyenneté recouvre un ensemble de droits et libertés. Au rang de ces droits et libertés figure en bonne place la liberté de circulation des personnes à l’intérieur de toute la zone. Cette liberté vise un objectif à terme à savoir permettre l’émergence d’une citoyenneté sous régionale », souligne l’universitaire centrafricain.
A l’écouter encore, ce qui caractérise la citoyenneté au sein de la Cemac c’est le sentiment d’appartenir à une Communauté qui dépasse les frontières nationales et au sein de laquelle se développent des projets communs. Ainsi, « est citoyen de la Communauté toute personne ayant la nationalité d’un État membre. La citoyenneté communautaire complète désormais donc la citoyenneté nationale sans toutefois la remplacer. Il importe tout de même de relever qu’à côté de la complémentarité entre la citoyenneté nationale et la citoyenneté communautaire, il y a une sorte de dépendance puisqu’avoir la nationalité d’un État membre est une condition nécessaire pour pouvoir bénéficier des droits et des libertés réservées aux citoyens de la Cemac. Il s’agit, entre autres, de la libre circulation, du droit d’élire les députés du parlement sous-régional et donc se sentir impliqué à la gestion de la chose communautaire».
La croissance via la libre circulation des personnes
Elle resterait hypothétique tant que les obstacles matériels qui freinent sa réalisation ne sont pas levés. « Les infrastructures, notamment leur mauvais état, sont…, à plus d’un titre, l’un des freins à l’intégration de la Cemac », commente Pr Jean-François Akandji-Kombé. Dans cette sous-région, poursuit-il, « il manque encore des voies de communication reliant les États de la zone entre eux. Or, comme le relève la doctrine, l’insuffisance et/ou la vétusté de ces infrastructures sont des obstacles matériels les plus sérieux à la mise en œuvre de la libre circulation des personnes ». On est là dans l’analyse du problème des infrastructures de communication en Afrique centrale. Posée comme telle, ladite analyse fait constater une insuffisance et une vétusté sur plusieurs plans. « Que l’on soit dans le domaine des infrastructures ferroviaires et aériennes ou dans celui des infrastructures fluviales et routières, leur état actuel symbolise le sous-développement de la sous-région et grippe par conséquent la croissance».
Bobo Ousmanou
Sortir du tumulte et des flonflons
Pour qui s’intéresse à la libre circulation des personnes dans l’espace Cemac, le zoom que nous proposons ici pourrait revêtir une certaine importance, à plusieurs titres. Tout d’abord, il s’insère dans le prolongement de la date du 16 mars 2025, jour de la célébration de la 16e Journée Cemac. Ensuite, il aborde sous un autre angle de questionnement, le thème retenu cette année (« Promouvoir les libertés de circulation pour renforcer les échanges intracommunautaires en zone Cemac ». Enfin, il place l’hebdomadaire Intégration dans son rôle : inscrire les items de la libre circulation dans le temps et l’espace Cemac.
Bien entendu, tout cela opère sur fond de discours insistant sur l’urgence de l’implémentation d’une véritable libre circulation dans l’espace Cemac. Et dans tous les cas, rien n’émerge qui pourrait laisser supposer un révisionnisme. Bien au contraire, le lecteur est invité à observer un tableau d’ensemble où la définition de la libre circulation des personnes en zone Cemac porte la signature d’éminents intellectuels, tous citoyens de la Communauté.
Citoyenneté
Pas très bien définie
Selon le Camerounais Belinga Zambo, la citoyenneté communautaire n’est pas suffisamment codifiée dans les textes organisant la Cemac et les pratiques communautaires en la matière inspirent encore peur et inquiétudes. Il se pose alors une interrogation fondamentale : la citoyenneté communautaire est-elle effective dans l’espace juridique de la Cemac ?

Elle décrit son père comme « Gabonais, citoyen de la Cemac, résidant à Port-Gentil ». Caroline Mbazoa a pourtant cru jusqu’à l’âge de 40 ans qu’elle pouvait partir de Yaoundé où elle réside avec sa mère et rallier Port-Gentil sans problème. La bascule s’est opérée le temps d’une conversation téléphonique, le 2 novembre 2020, quand son père l’a appelée pour lui annoncer, d’une voix chevrotante, qu’il lui fallait des tonnes de documents administratifs pour venir lui rendre visite au Cameroun. «Mon père m’avait expliqué que les autorités de son pays ne pouvaient pas non plus admettre que je me rende au Gabon sans visa », explique Caroline Mbazoa.
En analysant ce cas, Pr Belinga Zambo se lance dans une réflexion sur l’effectivité du cadre juridique de la citoyenneté communautaire en zone Cemac. «La mobilisation des textes et l’analyse des pratiques communautaires permettent d’observer que la citoyenneté en zone Cemac est une construction inachevée. Quoi qu’il en soit, il n’existerait pas de peuple Cemac ; il n’y aurait que des peuples nationaux. En fait, rien n’indique dans les textes de la Cemac qui est le peuple Cemac, de quoi serait-il constitué, ni quels sont les motifs de son unité ou les ressorts de sa cohésion sociale », dit l’universitaire camerounais.
Regard
Dans ce cas, l’on comprend que l’insuffisante codification de la citoyenneté communautaire dans les textes de la Cemac procède également de sa faible densité. « Le patrimoine juridique du citoyen communautaire est strictement circonscrit à un droit de vote aux élections au Parlement de la Cemac ; et à un droit de circulation et de séjour sur le territoire des Etats membres. La citoyenneté communautaire, dont les indices sont perceptibles dans les textes de la Cemac, qui s’inscrit dans une dynamique intégrationniste continue d’être hypothéquée par des pratiques déroutantes à la fois habituelles et nouvelles », explique Pr Belinga Zambo. Selon lui, ces pratiques peuvent s’expliquer par la diversité des approches normatives et les contraintes multiples de l’environnement sociopolitique et économique des États membres d’une part, mais aussi par les lacunes du système démocratique de la Communauté d’autre part. Tout pour faire constater que « les situations de discrimination dans les pratiques communautaires se traduisent par la persistance des pratiques de droit interne échappant à l’ordre juridique de la Communauté. D’une part, les États engagés dans le processus d’intégration régionale restent encore des entités souveraines ayant une compétence exclusive sur leur territoire en matière de législation et de règlementation. D’autre part, le processus de construction de la citoyenneté communautaire dans l’espace juridique de la Cemac subit le contrecoup de l’environnement sociopolitique et économique».
C’est que, concrètement, les États membres de la Cemac se réservent encore le droit de maintenir en vigueur, sous le fallacieux prétexte de la souveraineté nationale, des dispositions législatives souvent contraires aux objectifs de la Communauté (« les ressortissants des États membres de la Cemac jouissent de tous les droits et libertés reconnus aux nationaux du pays hôte sous réserve du respect des lois et règlements en vigueur dans ledit État »). Bien plus, les États engagés dans le processus d’intégration restent donc encore des entités souveraines ayant une compétence exclusive sur leur territoire en matière de législation et de règlementation.
Jean-René Meva’a Amougou
Infrastructures de transport
Des ambitions louables, mais mal coordonnéesPour Firmin Ouassalet Kanamba, acteur de la société civile congolaise, « la Cemac ne sera jamais une réalité sans des infrastructures d’intégration ».

La situation se veut tout illustrative de ce que l’on imagine difficilement compatible avec la libre circulation des personnes dans l’espace Cemac. Bien qu’on ait reconnu que l’émergence de pôles de compétitivité régionaux nécessite une chaîne logistique intégrée, avec le développement d’un transport multimodal intégrant le transport terrestre, maritime, aérien et ferroviaire, le déficit en infrastructures de transport encore constitue ainsi l’un des maillons faibles de la liberté de circulation. Des ambitions louables dans ce secteur n’ont pourtant pas manqué. On se souvient du projet Air Cemac dont l’ambition est restée virtuelle. Créée en 2001 par la volonté des chefs d’État, la compagnie avait pour vocation de desservir les capitales des États membres de la Communauté. Il s’est en effet posé le traditionnel problème de la souveraineté des États membres. On peut citer les cas du Cameroun et du Gabon qui ont manifesté le désir de conserver leurs compagnies nationales.
« Refuge »
« Cette difficulté d’organisation et de fonctionnement efficient des structures internes de ces organisations sous régionales d’intégration, constituées sous le critère de simple adhésion et sans une vision convergente d’intérêts, peut justifier de considérer en l’état actuel la Cemac comme une organisation de simple coopération entre États membres qui ont conservé tout entière leur souveraineté », jure Firmin Ouassalet Kanamba. Il poursuit : « La souveraineté des États membres restreint évidemment très fortement la réalisation de l’objectif de citoyenneté communautaire préalablement retenu par le Traité de la Cemac ». Traduction : Dans les pratiques communautaires, on observe un net mouvement de repli identitaire qui atteste de l’échec du projet citoyen de la Cemac. Les ressortissants des États membres se ressentent prioritairement et même exclusivement membres de leur communauté politique nationale et non d’une communauté politique communautaire largement hypothétique. « Nombre d’entre eux invoquent la fragilité du tissu économique et les problèmes de sécurité pour critiquer la politique migratoire de la Cemac. En premier lieu, le motif économique est constitué par le souci de protection de l’économie nationale et par conséquent du tissu social. Le motif économique pousse certains États, notamment les plus riches de la Communauté « à refermer davantage leurs frontières aux ressortissants d’autres pays membres, redoutant que les flux migratoires importants en provenance de ces États ne constituent un obstacle à la jouissance de leurs biens au profit de leur population ». Cette xénophobie « est expliquée par le souci de protéger l’ordre social, car la forte poussée de l’immigration aiguise les tensions sociales internes liées à l’accès à l’emploi et à la jouissance (des biens locaux et des opportunités) par les nationaux».
Exemple
En Guinée Équatoriale, lors de l’inauguration d’un champ pétrolier en début d’année 2008, la population a signifié son mécontentement du fait que plusieurs personnes de nationalité étrangère, et en l’occurrence les Camerounais, occupent des postes d’importance dans les sociétés pétrolières au détriment des nationaux. « La présence massive des étrangers, fussent-ils ressortissants communautaires, s’analyse donc en un danger pour l’équilibre social. Le poids économique de certains États membres laisse ainsi place à des pratiques protectionnistes qui affectent les libertés communautaires », conclut Firmin Ouassalet Kanamba.
Ongoung Zong Bella