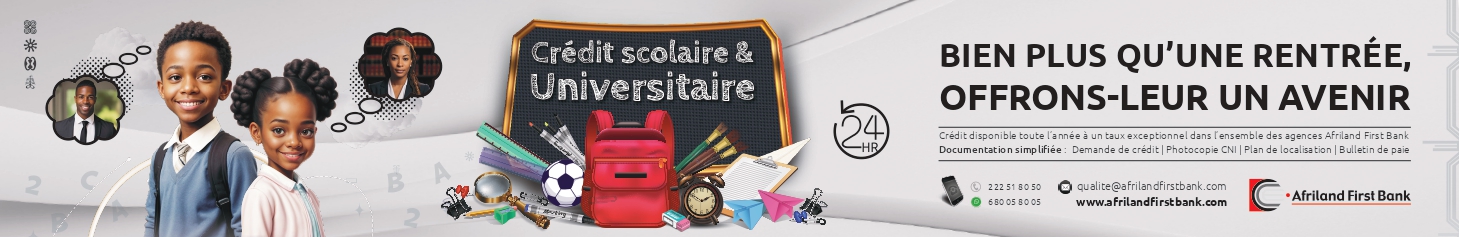Malgré son adhésion à l’initiative ITIE en 2005, le pays peine encore à assainir son secteur extractif. Au grand dam de la gente féminine.

La vie n’est pas dorée pour les femmes des localités reculées du Cameroun. S’il est aisé pour le commun des Camerounais de coller cette réalité aux cultivatrices, il lui faut gravir bien des degrés dans l’imaginatif pour savoir quelle est la condition des travailleuses artisanales des mines. En un cliché, leur vécu se raccroche au «soulé» ou à la «buchette» d’or qu’elles peuvent amasser tout au long du jour.
A cette réalité, Elisabeth Penken Epouse Nkolo, présidente de la Cellule associative des femmes actives pour la gouvernance des droits humains et du bien-être (Cafagb), se frotte depuis 2005. Elle en dresse un tableau où précarité, expropriation et risque de santé et de disparition, se disputent la part belle dans la vie de ces femmes. «Ces entreprises viennent et nous n’avons pas toujours les cahiers de charge signés avec l’Etat. Elles creusent des trous et beaucoup de femmes perdent leurs champs. Elles n’ont même plus où cultiver leur manioc, leur macabo, etc.
Elles se retrouvent sans moyen de subsistance et exposées à mourir; parce que quand on ne trouve plus de pépites, elles s’en vont creuser plus bas et là quelques fois des éboulements arrivent. Certaines meurent, d’autres ont de la chance et s’en sortent avec un handicap.
Quand les sociétés s’en vont, la convention de Ramsar demande 50 ans avant toute nouvelle culture, sinon il y a des produits comme le cyanure qui ne disparaissent pas immédiatement. On déplace ces femmes de leurs sites. Ne sachant pas comment négocier, on leur donne des montants dérisoires alors qu’elles n’ont plus de champ ni de maisons, les populations n’ont même plus accès aux forêts qui les nourrissent», relate-t-elle.
Norme ITIE
La gestion du secteur extractif doit pourtant se faire dans l’intérêt de tous les citoyens, celui des populations des localités minières en premier chef. Telle est la visée de l’Initiative pour la transparence dans le secteur extractif (ITIE) à laquelle le Cameroun adhère depuis 2005. Aussi, un décret du Premier ministre fixe depuis 2013, les conditions de réalisation d’études d’impacts environnementales.
A en croire ledit texte, celles-ci doivent se faire: «avec la participation des populations concernées à travers des consultations et audiences publiques, afin de recueillir les avis des populations». Elles apparaissent dans la réglementation camerounaise comme un préalable à l’octroi des titres miniers, ainsi que des autorisations et permis d’exploitation des carrières. L’ITIE introduit par ailleurs des exigences pour accroitre la compréhension publique de toute la mécanique autour de l’exploitation des ressources du sous-sol.
Aussi, le pays s’est doté courant 2016 d’un Code minier qui fixe les obligations des entreprises minières. Notamment: celles relatives au paiement d’une indemnité pour expropriation, à la formation, au développement des compétences et au recrutement des Camerounais, principalement les ressortissants des zones extractives dans les secteurs; au développement social de la population riveraine et autochtone;
Pourtant malgré les avancées, le chantier de la bonne gouvernance reste ardu dans le pays. En témoigne le rapport ITIE 2022 du Cameroun, publié en janvier 2025. Et qui donne un aperçu des manquements persistants à l’encontre des communautés. A l’occurrence: l’absence de divulgation des annexes des conventions minières qui empêche une évaluation complète des engagements sociaux des entreprises; la non publication des études d’impact environnemental, des audits environnementaux et sociaux, ainsi que des certificats de conformité environnementale.
A cela s’ajoute l’absence de mécanisme contraignant pour la mise à disposition de ces documents, ce qui freine l’accès à l’information par les parties prenantes. «Bien que la réglementation impose des consultations publiques, leur application reste partielle. Les Etudes d’impact environnemental ne précisent pas toujours le nombre de personnes consultées ni leur répartition par genre. Impact: Participation limitée des communautés, réduisant leur capacité à exprimer leurs préoccupations; risque de tensions sociales lié à un manque d’information et de dialogue», lit-on.
Péril sur les femmes
Ces contraintes ont un effet immédiat sur les conditions de vie de la gente féminine dans les localités extractives. Déjà sous l’emprise d’obligations familiales importantes, ces dernières font l’expérience des multiples facettes de la résilience. «Sur les sites, il y a des habitats de fortune qui sont construites avec des feuilles. Certaines ne rentrent pas le soir parce qu’elles doivent être là tôt pour récupérer leurs places dans la mine. Quand elles dorment là, vous pouvez imaginer la promiscuité qu’il y a dans ces abris.
Il faut aussi compter les maladies qui sortent de là et la violence. Parce que lorsqu’elles rentrent le soir et qu’elles ont vendu le soulé, ou la buchette ou le grain et qu’elle n’a rien eu à donner au mari, elles subissent des violences. C’est ça qui amène plusieurs à fuir la maison pour regagner ces abris de fortune. D’autres encore finissent pas fuir le foyer parce que ne supportant plus de donner son argent à un mari qui a démissionné de ses fonctions une fois le champ.
Dans ces abris, on réunit des feuilles et des branches d’arbres pour former un lit pour pouvoir dormir. Si à la fin de la journée de travail, elle a même un mal de tête, elle est obligée d’aller chez les vendeurs du coin pour acheter même un paracétamol. Mais quel est le médecin qui l’a consultée», déplore la sexagénaire dont la suite du discours trouve un écho dans les souvenirs de Bertrand Awaseh, ancien employé de mine dans le village aurifère de Colomine, dans le département du Lom et Djerem, région de l’Est.
Ce dernier liste une série de drames affectant ces opératrices. «Les femmes sont nombreuses dans les activités auxiliaires mais exposées à des grandes difficultés. Comme il y’a l’absence de protection, il y a le harcèlement, il y a les violences et le manque d’accès à des services sociaux. Ce n’est pas vraiment facile pour des femmes de s’en sortir dans ce secteur. Pour leur santé, des fois des ONG les appuis avec des campagnes de santé reproductive et de lutte contre le VIH et certains sinistres. Il faut des infrastructures sanitaires pour elles», déclare ce technicien industriel.
Des besoins non comblés
La réalisation d’infrastructures genrées est une préoccupation constante à Betaré Oya, une commune aurifère de 59 villages dans le Lom et Djerem. Le maire Nicolas Baba, en a pris la pleine mesure depuis son élection en 2020. «On est parti du bas vers le haut, c’est à dire à partir de là où on n’a jamais investi, on a pu recenser 7 villages, nous avons arrêté des projets et nous avons lancé la contractualisation. Certains ont été exécutés et d’autres non suite à un problème avec les impôts», explique l’élu local.
Les fonds pour le faire, ont été majoritairement tirés de la redevance minière reversée courant 2021. Seul bémol à l’ombre de ce tableau: les transferts de fonds se raréfient et les informations sur les dus de la commune relèvent d’un secret de polichinelle. «Actuellement c’est notre combat. Au sein de l’Association des communes minières, nous sommes en train de faire un plaidoyer auprès de l’Etat pour qu’on puisse accélérer les choses, parce que selon certaines sources, la répartition a déjà été faite.
Il reste juste que le ministre des Finances mette ça à la disposition des communes. Dans les textes, il est prévu qu’au moment de recueillir le produit, la mairie doit être représentée pour qu’elle sache ce qui lui revient. Mais ce n’est pas ce qui se passe. La gestion de l’or est tellement opaque», explique Nicolas Baba.
Le ministre des Finances a défini les quote-parts des recettes dus aux communes minières dans son arrêté du 16 juillet 2025. Il s’agit de 2% sur les droits de concessions domaniales; 2% au profit des populations riveraines et 6% pour les communes des sites dans le cadre de la taxe ad valorem pour la petite mine, l’artisanat minier et la mine industrielle ; 2% pour les populations et 5% pour la commune territorialement compétente en matière de taxe à l’extraction (reversés dans les comptes de la recette municipale) et 3% pour la commune (déposés dans les comptes spéciaux).
A ceux-ci s’ajoutent des recettes prélevées au bénéfice de l’ensemble des collectivités décentralisées. Une divulgation systématique des données désagrégées et ventilées par région aurait pu combler le gap en matière d’informations. Seulement le chantier de l’exploitation de ces documents relève d’un parcours de combattant. Outre, la multiplicité des documents existants sous des formats PDF complexes, loin du Comma-séparated values (CSV) ou du format Excel requis pour présenter les données sous forme tabulaire ; il faut encore composer avec une procédure de certification des comptes longue.
Plus encore, la Norme ITIE 2019 préconise des données facilement compréhensibles. Le constat fait par l’auteur de cet article établit une technicité des données qui en appellent à une culture solide en matière de finances publics. De quoi créer ce que dit la loi.
Louise Nsana