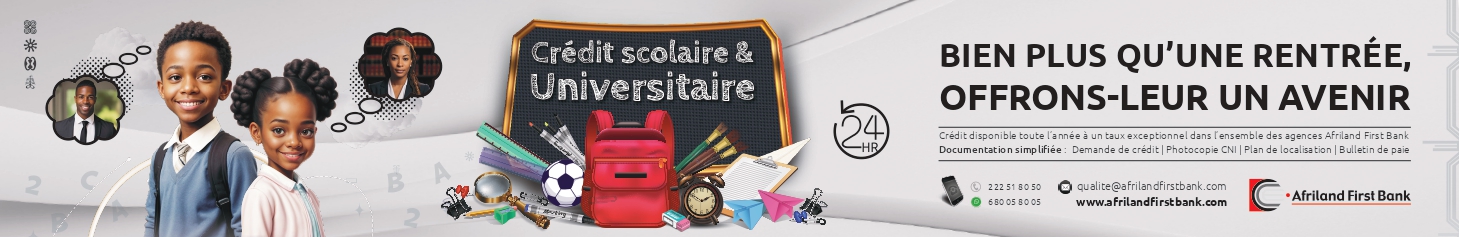Dans un contexte où les changements climatiques perturbent profondément les modes de vie des communautés rurales et où l’accès aux ressources financières reste limité pour les femmes, Intégration a rencontré l’experte en management des organisations communautaires et développement local au Cameroun. Elle nous livre son analyse des difficultés rencontrées par les femmes et les solutions que pourraient mettre en œuvre les institutions publiques pour y remédier.

Dr. Ngassa, quelles sont, selon vous, les principales difficultés que rencontrent les femmes rurales face aux changements climatiques au Cameroun ?
Les femmes rurales sont les premières victimes des variations climatiques. Elles gèrent l’agriculture familiale, l’approvisionnement en eau et la nutrition des enfants. Or, la sécheresse, les inondations et l’érosion des sols rendent ces tâches quotidiennes de plus en plus ardues. À l’Ouest et dans le Nord, certaines cultures essentielles comme le maïs ou le manioc échouent avant maturité, entraînant une insécurité alimentaire pour toute la famille. La pression est immense, car elles doivent répondre aux besoins immédiats de leurs familles tout en essayant d’anticiper des saisons imprévisibles. De nombreux témoignages illustrent à quel point le quotidien des femmes rurales est directement impacté par le climat et comment cette instabilité affecte la sécurité alimentaire, l’éducation des enfants et même la santé familiale.
Et qu’en est-il de l’accès aux ressources financières ?
C’est un vrai casse-tête. Les institutions financières formelles restent largement inaccessibles aux femmes rurales, souvent en raison de la nécessité de garanties foncières ou de documents administratifs qu’elles ne possèdent pas. Beaucoup se tournent vers le microcrédit ou les tontines, mais ces solutions ne suffisent pas à financer des projets agricoles innovants ou à compenser les pertes dues aux catastrophes climatiques. Cela limite leur capacité à investir dans des semences de qualité, de petits équipements agricoles ou même des activités génératrices de revenus complémentaires, les maintenant dans un cycle de vulnérabilité. Pour beaucoup, l’accès au financement reste une promesse non tenue, alors que ces femmes sont prêtes à investir leur travail et leur savoir-faire.
Face à cette situation, quelles solutions concrètes les institutions publiques pourraient-elles mettre en place ?
Il y a plusieurs axes. Premièrement, améliorer l’accès aux financements. Les banques et coopératives pourraient créer des produits adaptés aux femmes rurales, comme des microcrédits garantis par l’État ou des fonds de résilience climatique. On pourrait aussi renforcer les partenariats public-privé pour subventionner l’achat de semences résistantes à la sécheresse ou d’équipements agricoles modernes. Des initiatives pilotes dans certaines régions montrent déjà que lorsque l’État soutient directement les groupements de femmes, les résultats sont tangibles.
Deuxièmement, la formation et l’accompagnement sont essentiels. Les femmes doivent être formées aux techniques agricoles adaptées au changement climatique : irrigation goutte-à-goutte, agroforesterie, diversification des cultures. Les services publics de vulgarisation agricole doivent intensifier leurs visites sur le terrain et offrir des conseils personnalisés. Ces formations ne se limitent pas à l’agriculture : elles incluent aussi la gestion financière de l’exploitation, la constitution de coopératives et l’accès aux marchés locaux.
Troisièmement, il faut une approche de planification participative. Les femmes doivent être incluses dans les comités de gestion des ressources naturelles et des budgets communaux. Leur expérience du terrain est une richesse pour élaborer des politiques efficaces et durables. À l’Extrême-Nord, certaines communautés ont mis en place des systèmes de stockage de l’eau gérés par des groupes de femmes locales, qui pourraient être financés et étendus grâce à l’appui de l’État. Ce type d’implication favorise également la responsabilisation et la pérennité des initiatives locales.
Certaines femmes dénoncent un manque de coordination entre les ministères et institutions publiques. Comment améliorer cela ?
La fragmentation est un problème récurrent. Il faut des mécanismes de coordination plus efficaces entre le ministère de l’Agriculture, celui de la Femme et de la Famille, le ministère de l’Économie et les institutions financières publiques. Une « plateforme multisectorielle » pourrait centraliser les informations sur les programmes disponibles, simplifier les démarches administratives et permettre aux femmes rurales de bénéficier plus facilement des subventions ou des prêts. Les nouvelles technologies, comme les applications mobiles de suivi et de paiement, sont aussi des outils prometteurs pour connecter ces femmes aux services financiers et aux informations agricoles. Une meilleure coordination permettrait d’éviter que certaines initiatives se chevauchent ou échouent faute de suivi, et renforcerait la confiance des communautés dans les institutions publiques.
Dans le domaine de l’éducation et de la sensibilisation, que peuvent faire les institutions ?
L’éducation est un pilier. Les femmes rurales doivent être informées sur les droits fonciers, les opportunités financières et les pratiques agricoles résilientes. Les programmes radio et mobile sont très efficaces pour toucher les zones reculées. Il faut aussi soutenir l’enseignement technique et l’alphabétisation financière, afin que ces femmes puissent non seulement cultiver, mais gérer leurs revenus et épargner intelligemment. Les institutions peuvent également développer des programmes de mentorat, mettant en relation des femmes expérimentées avec des jeunes rurales pour transmettre des savoirs pratiques et des techniques d’adaptation au changement climatique.
Selon vous, ces mesures sont-elles réalisables à court terme ?
Oui, mais elles nécessitent une volonté politique forte et des financements ciblés. Il ne s’agit pas seulement d’investir de l’argent, mais de réorganiser les services publics pour qu’ils deviennent réellement accessibles et inclusifs. L’expérience montre que lorsque les institutions s’impliquent directement dans le soutien aux femmes rurales, les résultats sont visibles : augmentation des rendements agricoles, meilleure sécurité alimentaire et plus grande autonomie économique des ménages. Ce n’est pas seulement une question de justice sociale ; c’est aussi un investissement stratégique pour la résilience économique du pays.
Pour conclure, quels seraient les messages clés à transmettre aux décideurs publics ?
Trois messages principaux : intégrer les femmes rurales dans toutes les politiques de développement local, simplifier et sécuriser l’accès aux ressources financières et investir dans des formations pratiques adaptées aux réalités climatiques. Chaque mesure prise pour soutenir ces femmes a un effet multiplicateur sur toute la communauté. En soutenant celles qui nourrissent et entretiennent nos villages, on investit dans la résilience de tout le pays. Les décideurs doivent comprendre que ces interventions ne sont pas seulement philanthropiques ; elles sont vitales pour la sécurité alimentaire, la cohésion sociale et le développement durable du Cameroun.
Propos recueillis par Jean-René Meva’a Amougou