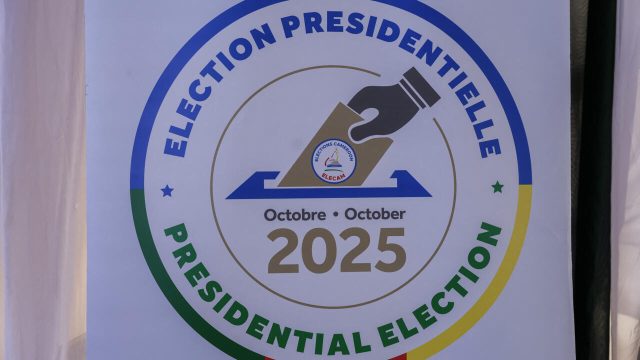Faits et méfaits repérés sur la route vers le palais d’Etoudi
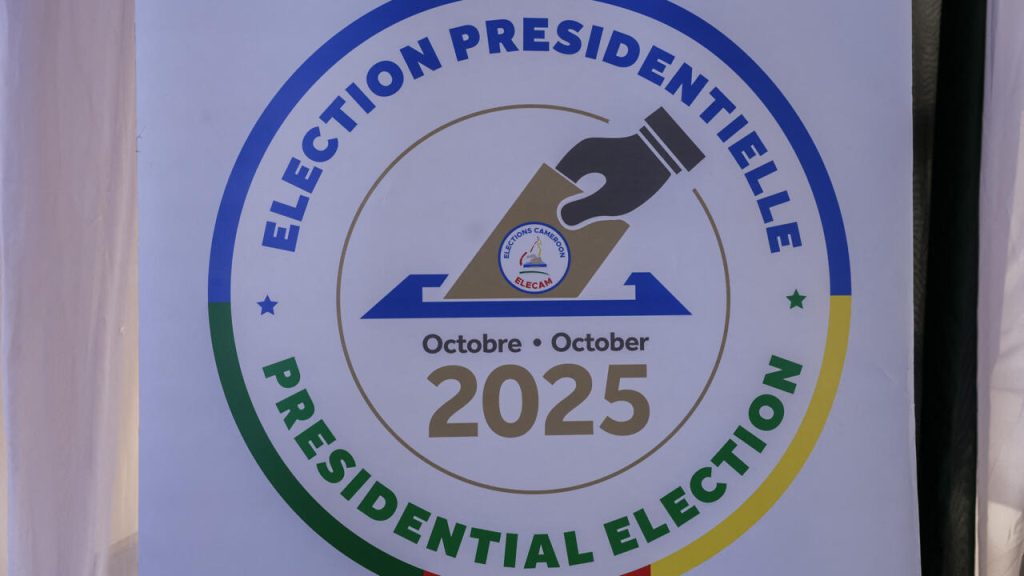
À Bafoussam, Mgr Lontsie-Keune troque sa chasuble pour le rôle de coach électoral. L’évêque, visiblement inquiet de voir les Camerounais voter à l’aveugle, a livré sa recette pour une présidentielle 100 % transparente le 12 octobre 2025. Première étape : un débat télévisé où les 12 candidats (oui, douze !) devront se montrer plus clairs qu’un bon café du matin. « Nous voulons voir ceux qui aspirent à gouverner, et chacun doit choisir en conséquence », martèle-t-il, avec le sérieux d’un professeur de maths.
Puis, place au vote… et surtout à la surveillance ! L’évêque rappelle : « Ne laissez pas voler votre vote », comme si le scrutin se jouait dans un film de cape et d’épée. Les candidats, eux, envoient leurs scrutateurs, qui ressemblent parfois à des détectives en mission secrète dans les bureaux de vote.
Mais l’injonction la plus mémorable reste sans doute celle du décompte des voix : « Ceux qui comptent doivent se souvenir de leur baptême… 1+1=2 », rappelle-t-il. Morale de l’histoire : même Dieu surveille les additions électorales !
12 est en ébullition !
Douze candidats, douze promesses, douze sourires de campagne… et le tout pour un scrutin qui tombe le 12 ! Si le calendrier avait un sens de l’humour, il se serait surpassé. À ce rythme, les électeurs pourraient se croire dans un jeu de société géant : « Choisis ton champion, lance le dé et avance jusqu’au 12 ! »
Chaque candidat joue sa carte : l’un promet 12 milliards pour l’éducation, l’autre 12 minutes de concert par jour dans les écoles… et le dernier, fidèle à son style, assure que 12 jours suffiront pour résoudre tous les problèmes du pays. Les meetings ressemblent à des parties de dominos : chacun tente de faire tomber le suivant avec des slogans plus inventifs que jamais.
Et le peuple ? Entre les 12 programmes, les 12 affiches et les 12 discours, il jongle, rit, soupire… mais surtout, il attend le 12, le jour où le dé sera lancé et le suspense enfin tranché.À la télévision, les débats durent 12 minutes (pas une de plus, pas une de moins), et chaque candidat doit citer 12 raisons pour lesquelles il est le meilleur. Dans les rues, les affiches sont collées par groupes de 12, et les électeurs comptent leurs pas : 12 vers la mairie, 12 vers le marché, 12 vers le bureau de vote.
Même les analystes politiques s’y mettent : « Si chacun des 12 candidats gagne 12 % des votes, alors… » – personne ne finit la phrase, mais tout le monde rit quand même. Et les meetings ? Ils ressemblent à des chorégraphies de 12 pas, avec 12 applaudissements synchronisés et, bien sûr, 12 selfies par minute. En attendant, vive le 12, le chiffre roi de cette présidentielle pas comme les autres !
Mais le plus cocasse, c’est quand un simple émissaire du parti débarque en tournée. Aussitôt, les communicants se métamorphosent en fidèles en transe : on se prosterne, on acclame, on jure fidélité comme à l’époque des chevaliers et des seigneurs. Les micros deviennent des encensoirs, les slogans des psaumes, et chaque phrase du visiteur se transforme en verset politique. Les discours, déjà formatés pour la télévision, prennent alors une dimension mystique : on ne parle plus de programmes ou de projets, mais de saintes promesses qui défient le temps et la raison.
Alors on imagine la scène : si un simple émissaire déclenche une telle ferveur, que se passerait-il si Paul Biya lui-même foulait la poussière de la campagne ? On assisterait sans doute à un séisme protocolaire : communicants à genoux, caméras en lévitation, militants en transe mystique. Les rues se changeraient en sanctuaires, et le micro deviendrait ostensoir. Chaque poignée de main serait un miracle, chaque sourire un sermon. Les journalistes, eux, se demanderaient s’ils couvrent un meeting ou une procession religieuse.
Et pendant ce temps, les idées, les projets, les débats politiques ? Disparaissent dans le brouhaha de la dévotion. Les programmes deviennent secondaires face à la performance rituelle, et le terrain électoral ressemble plus à une scène de théâtre sacré qu’à une compétition démocratique. Les communicants, épuisés par l’exaltation qu’ils provoquent, en oublient parfois même les candidats qu’ils sont censés promouvoir : ils semblent danser pour le public, applaudir pour la caméra, bénir pour le micro.
À ce rythme, la campagne tient plus du pèlerinage que du débat d’idées. À force d’adorer les messagers, on finit par oublier le message. Et le spectateur, lui, oscille entre le rire et la perplexité : doit-il voter, prier, ou simplement admirer le spectacle ?
Déboires
La campagne présidentielle 2025 tourne parfois à la comédie improvisée. On y voit des communicants de partis, censés galvaniser les foules, perdre soudain leurs moyens dès que la petite lumière rouge de la caméra s’allume. Certains bafouillent comme des étudiants à un oral surprise, d’autres récitent leur discours avec l’émotion d’un robot mal programmé.
Entre deux maladresses, on entend des perles : « Notre candidat incarne le futur… depuis longtemps », ou encore « Nous promettons le changement dans la continuité, mais en mieux ». Les cameramen, eux, retiennent leurs rires héroïquement.
Les communicants rivalisent de fébrilité, brandissant des fiches froissées, ajustant leurs cravates imaginaires, pendant que leurs candidats espèrent que personne ne verra le désastre sur les réseaux sociaux. À ce rythme, les électeurs risquent de voter pour le plus à l’aise à l’écran — quitte à ce que ce soit le journaliste.À Yaoundé, Douala et même à Sangmélima, les scènes rappellent les grands jours de distribution de riz subventionné : bousculades, cris, pagnes qui volent dans tous les sens. Cette fois, l’objet de la convoitise n’est pas comestible mais textile : le nouveau pagne à l’effigie de Paul Biya.
Sur fond bleu présidentiel, le visage du Chef de l’État trône, sourire immuable, entouré de colombes et de slogans promettant « paix et continuité ». Un symbole si puissant que certains en oublient la bienséance : on s’arrache le tissu comme si c’était la dernière relique du régime.
« J’en veux deux pour coudre mes rideaux ! », lance une maman essoufflée. « Moi c’est pour mon mariage, ça porte bonheur », renchérit un jeune. Pendant ce temps, les tailleurs se frottent les mains — et les militants les genoux, après les bousculades.
On raconte même qu’un commerçant aurait proposé un demi-pagne contre une carte d’électeur bien tamponnée. Le pagne, désormais, n’habille plus seulement les corps, il habille les convictions. Il aura fallu presque une décennie et quelques cheveux blancs pour que Tchiroma Bakary découvre la douce mélodie du mot « pardon ». L’ancien ministre de la Communication, jadis chef d’orchestre du « tout va bien au Cameroun », s’est rendu à Bamenda pour confesser ses « excès de langage » au début de la crise anglophone. On l’a vu, micro tremblant, voix contrite, prononcer des phrases qu’on n’aurait jamais imaginées sortir de sa bouche sans autorisation ministérielle.
« J’ai parlé sans mesurer la douleur de mes frères », a-t-il dit. Les habitants de Bamenda, entre stupéfaction et fou rire, se demandaient si c’était bien le même homme qui, à l’époque, expliquait que tout allait pour le mieux dans le meilleur des Cameroun possibles. Certains auraient même cherché la caméra cachée.
Mais après tout, mieux vaut tard que jamais. Dans un pays où les excuses sont plus rares qu’une route sans nid-de-poule, voir Tchiroma s’incliner, c’est presque un événement national. Reste à savoir si le pardon s’accompagnera d’un retour politique ou simplement d’une tournée d’absolution médiatique.
JRMA