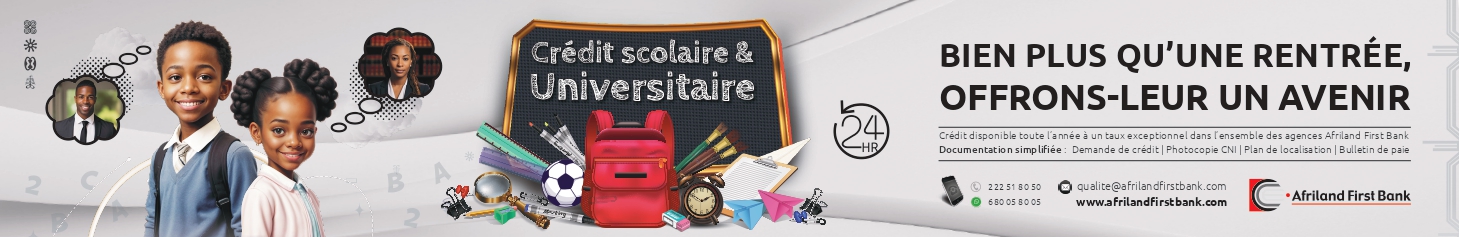Le président du comité d’organisation de la PépiDoc SEGes 2025 traite des contours et des ressorts de l’événement.

Depuis 2019, la coopération française au Cameroun accompagne les enseignants et chercheurs. Ce projet a franchi plusieurs étapes et s’étend aujourd’hui aux étudiants de toute l’Afrique centrale à travers la Pépinière doctorale. Qu’est-ce qui change fondamentalement ?
Ce qui change, c’est notre capacité à nous adapter aux mutations rapides de notre environnement socio-économique. La CEMAC est aujourd’hui confrontée à de grands défis : une économie marquée par la dépendance aux matières premières, des systèmes éducatifs encore fragiles, et une jeunesse nombreuse qui aspire à trouver sa place. Il fallait donc que la Pépinière doctorale se mette au diapason de ces réalités.
Cette année, en partenariat avec l’ambassade de France, le Service de coopération et d’action culturelle et d’autres acteurs institutionnels, nous avons choisi de mettre en avant une thématique incontournable : l’intelligence artificielle. Vous savez que l’IA est en train de transformer les habitudes de travail, les méthodes d’enseignement et même nos comportements quotidiens. La nouveauté, c’est donc cette volonté d’inscrire les doctorants et chercheurs d’Afrique centrale dans cette dynamique mondiale, afin qu’ils ne soient pas de simples spectateurs, mais des acteurs capables de l’adapter à leur environnement.
Justement, comment intégrer l’IA comme outil de recherche dans un environnement aussi difficile que celui de l’Afrique centrale ?
C’est un vrai défi, car nos contextes sont marqués par des contraintes structurelles : enclavement, faiblesse des infrastructures numériques, coûts élevés de la connexion internet, et manque d’accès à une documentation scientifique actualisée. Beaucoup de jeunes chercheurs se retrouvent isolés et peinent à développer une méthodologie solide.
La Pépinière doctorale est venue combler ce vide. Depuis 2019, nous avons progressivement construit un dispositif qui brise cet isolement. Grâce aux bourses et aux partenariats noués avec des laboratoires français, les doctorants ont désormais accès à des bases de données, des logiciels d’analyse, et des bibliothèques virtuelles qu’ils ne pouvaient pas consulter auparavant.
Intégrer l’IA, c’est d’abord permettre aux jeunes de voir cet outil comme un facilitateur : dans la collecte et le traitement des données, dans la modélisation économique, dans l’analyse des politiques publiques. Mais c’est aussi une opportunité pour créer des solutions adaptées aux réalités locales. Par exemple, l’IA peut être utilisée pour anticiper l’évolution des prix des matières premières, pour simuler l’impact des politiques fiscales, ou encore pour analyser les effets du changement climatique sur l’agriculture en Afrique centrale.
On parle d’un focus sur les sciences économiques et de gestion. Pourquoi ne pas élargir à d’autres disciplines, comme les sciences juridiques ?
Il faut préciser que la Pépinière doctorale n’est pas un projet isolé. C’est un maillon d’un ensemble d’initiatives que porte la coopération française dans différents domaines. En sciences juridiques, par exemple, un autre programme existe déjà, coordonné par le professeur Kenfack, président de l’Université Toulouse Capitole. Ce programme prépare les jeunes enseignants-chercheurs d’Afrique centrale à l’agrégation, une étape cruciale pour renforcer les capacités de nos universités.
Le choix des sciences économiques et de gestion répond à une urgence particulière : nos économies peinent à se transformer et à créer de la valeur ajoutée. Nous avons besoin de compétences capables de penser la fiscalité, la gestion publique, l’entrepreneuriat, la transformation industrielle. C’est là que les doctorants en sciences économiques et de gestion peuvent avoir un impact immédiat. Leur rôle est d’apporter des solutions concrètes, applicables dans le monde du travail et utiles pour les décideurs politiques.
Quelle place accordez-vous à la professionnalisation dans ce projet ?
Elle est centrale. Longtemps, on a considéré la thèse comme un exercice purement académique, déconnecté de la réalité économique et sociale. Or, notre conviction est que la recherche doit produire un savoir utile. Un doctorant ne doit pas se limiter à produire un document de plusieurs centaines de pages qu’on dépose dans une bibliothèque. Il doit être en mesure de répondre à une question simple : « Qu’est-ce que ma recherche résout dans mon environnement ? »
C’est pourquoi nous parlons d’incubateur de savoir. La Pépinière met les doctorants en situation de confrontation avec des acteurs économiques, des institutions publiques, des chambres consulaires. Nous voulons les amener à développer des recherches qui débouchent sur des solutions de transformation : améliorer la compétitivité des entreprises, mieux gérer les ressources fiscales, anticiper les crises alimentaires ou énergétiques. La professionnalisation, c’est donc donner aux doctorants la conscience qu’ils sont des bâtisseurs du développement, pas seulement des universitaires.
Accompagnez-vous les doctorants jusqu’à la fin de leur parcours ?
Absolument. Notre rôle n’est pas seulement de leur offrir une formation ponctuelle. Nous les suivons tout au long de leur cheminement académique. Aujourd’hui, plus d’une douzaine ont déjà soutenu avec succès leur thèse dans des universités camerounaises. Et nous constatons avec fierté qu’ils occupent des postes stratégiques, qu’ils publient des articles de qualité et qu’ils participent à des débats de société.
Mais il reste un problème majeur : le financement de la recherche. Les États de la sous-région consacrent encore trop peu de ressources à ce secteur. Nous plaidons pour un virage vers ce qu’on appelle la « recherche-développement », qui implique une collaboration plus étroite avec le secteur privé. Car ce sont les entreprises qui connaissent les besoins du marché et les métiers de demain. La recherche doit être pensée comme un levier de compétitivité pour nos économies, et non comme un exercice isolé.
Quelles sont les perspectives immédiates pour la Pépinière doctorale ?
En guise de rappel, la pépinière doctorale en sciences économiques et de gestion est une initiative mise sur pied depuis 2019. Elle enregistre à date, 17 lauréats soit 02 en 2020 ; 05 en 2022 ; 05 en 2023 ; 05 en 2024. Nous avons lancé un appel à candidatures en mai dernier, diffusé sur toutes les plateformes numériques et dans les universités. Les soumissions sont ouvertes jusqu’au 10 septembre. Le 19 septembre, un jury composé d’experts sélectionnera les meilleurs projets, avec une attention particulière pour la participation féminine. Du 25 au 27 novembre, ces projets seront présentés dans le cadre d’une compétition scientifique. Les lauréats bénéficieront d’une bourse de recherche pour poursuivre leur travail dans des laboratoires partenaires.
À moyen terme, nous travaillons avec la Commission de la CEMAC sur la création d’une bourse d’excellence régionale. L’idée est de renforcer le dispositif pour qu’il bénéficie à un plus grand nombre de doctorants. Nous devons aussi répondre à une autre urgence : le renouvellement des enseignants-chercheurs. Certains pays de la sous-région manquent cruellement de professeurs. Le Cameroun, avec son vivier académique, peut jouer un rôle de locomotive et mutualiser ses compétences.
En résumé, la Pépinière doctorale est un outil stratégique : elle permet de former une nouvelle génération de chercheurs ancrés dans la réalité, capables d’anticiper les transformations économiques, et déterminés à mettre la science au service du développement de l’Afrique centrale.
Propos recueillis par JRMA