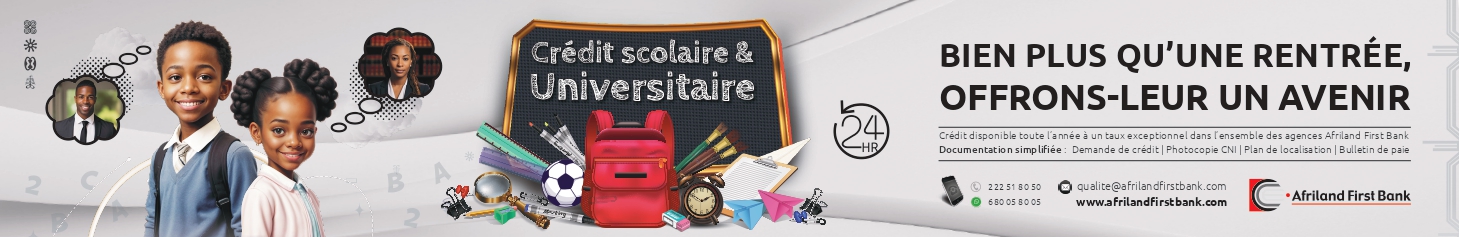Le spécialiste des Relations internationales, doyen de la Faculté des sciences juridiques et politiques à l’Université de Dschang, porte un regard sur la tenue récente de deux sommets de chefs d’Etat sur l’intégration en Afrique centrale, à travers la CEEAC et la CEMAC.

En votre qualité d’observateur averti des problématiques d’intégration en Afrique centrale, comment vous appréhendez la tenue en l’espace de trois jours de deux sommets des chefs d’État de la CEEAC et de la CEMAC ?
Au plan institutionnel rien n’interdit à ces deux organisations sous-régionales de tenir chacune un sommet séparé dans la mesure où elles sont indépendantes, peuvent avoir des agendas politiques différents bien qu’elles aient des objectifs globaux presque similaires. On pourrait penser qu’au plan opérationnel cela présente des difficultés parce que les mêmes plénipotentiaires vont se déplacer de Malabo à Bangui en l’espace de quelques jours pour traiter des dossiers qui peuvent similaires puisque les six Etats de la CEMAC sont également membres de la CEEAC.
Mais non seulement les deux ordres du jours ne sont pas les mêmes, mais en plus de cela dans le travail communautaire comme en diplomatie en général, les sommets ne viennent que couronner le travail longtemps préparé par les fonctionnaires de la Communauté, les experts, les représentants permanents, les ambassadeurs et les conseils des ministres ; les chefs d’Etat ne viennent qu’adopter les décisions finales (à l’unanimité, par consensus ou à la majorité des 2/3), c’est pour cela d’ailleurs que les sommets ne durent pas plus de deux jours.
Les experts et les représentants dont il est question ne sont pas les mêmes à la CEEAC comme à la CEMAC. C’est au niveau de la cohérence dans l’action pour une même sous-région que l’on pourrait penser à une cacophonie, mais à partir du moment où il y a des pays de la CEEAC qui n’appartiennent pas à la CEMAC et qui peuvent avoir des problèmes différents, cela suppose que la CEEAC peut avoir des questions à l’ordre du jour qui ne sont pas connues par la CEMAC. En plus si l’on a accepté le principe de deux institutions (voire trois avec la CEPGL), il faut également accepter le principe de leur autonomie y compris tant dans l’élaboration de leur agenda que dans la tenue presque simultanément de leurs sommets.
Ceci n’est-il pas révélateur d’un freinage des quatre fers de la finalisation de la rationalisation ?
Qu’on se le dise bien ! Il y a plusieurs formes de rationalisation qui ont été presque théorisées par la Commission économique des Nations unies pour l’Afrique et l’Union africaine, l’objectif général étant de s’attaquer à la fragmentation des espaces régionaux, aux institutions qui se recouvrent partiellement, à la duplication des efforts, à la dispersion des ressources, et aux querelles de légitimité découlant des multiples traités des CER et des communautés économiques sous régionales.
Les deux organismes distinguent la rationalisation par fusion et par absorption, la rationalisation autour des communautés enracinées, la rationalisation à travers la répartition des tâches et la rationalisation par l’harmonisation et la coordination. Après des expérimentations sans succès d’une rationalisation par fusion/absorption, notamment en Afrique de l’Ouest, la CEA et l’UA ont finalement recommandé aux Etats une rationalisation par l’harmonisation et la coordination des politiques, programmes et instruments d’intégration dans chaque région.
Dans ma lecture personnelle de la Déclaration de Brazzaville du 30 octobre 2007, qui n’est pas une lecture officielle, il me semble que c’est cette option qui a été également retenue par les chefs d’Etat d’Afrique centrale et non la rationalisation par fusion/absorption des trois institutions comme semblent le penser certains. Pour cela, ils ont invité les présidents en exercice de la CEEAC et de la CEMAC à mettre sur place conjointement, un comité de pilotage en vue de l’élaboration d’une feuille de route définissant les actions d’harmonisation des politiques, des programmes et instruments d’intégration des deux communautés pour aboutir « à terme » à une seule CER dans la région de l’Afrique centrale. Donc l’idée d’aboutir à une seule CER n’est alors envisageable comme le précise la Déclaration de 2007, qu’« à terme ».
Autrement dit, l’unification des cadres institutionnels ne doit intervenir qu’au terme du processus de rationalisation. C’est la finalité et non le début de la rationalisation, car la locution adverbiale « à terme » signifie « dans un futur indéterminé, mais immanquablement ». Il s’agit d’une échéance assez éloignée dans le temps. La fusion pour une seule CER est alors considérée comme la fin du voyage de l’intégration en Afrique centrale, or l’intégration n’a pas de fin, c’est un processus. Et pour quiconque connait l’histoire de la naissance de ces regroupements en lien avec la géopolitique européenne sans oublier l’état d’esprit même des fonctionnaires communautaires sur la question, l’on sait bien que la CEMAC ne peut pas disparaître de sitôt au profil de la seule CEEAC.
Pourquoi un sommet extraordinaire de la CEEAC en ce moment ?
D’abord parce que le traité le lui autorise (article 13 du traité révisé). Ensuite, officiellement le communiqué du 07 septembre dernier parle clairement du renouvellement de l’Exécutif communautaire puisqu’on est arrivé à la fin du mandat de la première mandature de l’exécutif communautaire sortant que dirigeait SE Monsieur VERISSIMO. Et comme nous sommes dans un régime de mandat unique sans possibilité de renouvellement rien n’interdisait la CEEAC de tenir ce sommet, mis à part tous les non-dits qui ont circulé.
Quelle est votre analyse des grandes lignes du communiqué final sanctionnant les travaux de Malabo ?
Globalement il y a un souci de respect de la légalité communautaire. C’est à saluer malgré les tensions qui existent entre les pays appartenant à la même organisation dont l’un est accusé d’agresser l’autre depuis de longues dates.
Le nouveau patron de la Commission de la CEEAC est un ressortissant du Burundi. Son pays n’a pas toujours été aux avants – postes pour ce qui est de l’intégration régionale. Sa tâche ne risque t- elle pas d’être ardue ?
Justement n’est-ce pas une manière pour le Burundi d’être plus actif au plan communautaire et d’apporter toute son énergie à la stabilité, à la mise en œuvre des réformes engagées au sein de cette institution au milieu des années 2010 avec pour objectif général l’amélioration de l’efficacité et de l’efficience de la CEEAC, afin de réaliser un saut qualitatif majeur dans la gouvernance organisationnelle et financière, pour en faire une Communauté économique régionale viable, forte. Le Burundi peut également jouer un rôle de médiation entre le Rwanda et la RDC dont on connait la nature du conflit.
Le cas de la RDC est passé officiellement sous silence à Malabo. Peut-on sérieusement envisager l’intégration en Afrique centrale sans la RDC, pays – sous-continent ?
Le point 10 du communiqué final de Malabo traite bel et bien de la « situation dramatique à l’Est de la RDC où le territoire reste sous l’emprise d’un groupe armé soutenu de l’extérieur ». La Conférence a appelé à la mise en œuvre immédiate de la résolution 2773 du CSNU tout en saluant les efforts de paix menés à Lomé, Doha et Washington. Le problème de la RDC est de savoir si les mêmes puissances qui adoptent les résolutions au Conseil de sécurité ne sont également pas impliquées à quelques degrés que ce soit dans le conflit ?
Revenons à la CEMAC. L’ordre du jour de la 16e conférence des chefs d’État ne dégage rien de fort. Pourtant la sous-région est travaillée par des crises profondes sur les plans économiques, politiques, sécuritaires et sociales. Comment comprendre l’indolence des dirigeants à prendre des mesures fortes ?
Pourtant à chaque fois qu’il a présidé aux destinées de la CEMAC ces dernières années de crises le président Paul Biya par exemple a souvent fait adopter des mesures concrètes et audacieuses à ses pairs tant au plan du relèvement économique, de la stabilité financière, de la paix et de la sécurité. Pour le sommet du 10 septembre 2025, je vois dans le projet d’ordre du jour des questions d’une très grande importance à l’instar du rapport du Président Sassou Nguesso sur le PREF-CEMAC, qui est depuis la fin de la décennie 2010, avec ses cinq piliers (politiques budgétaires, politiques monétaires et système financier, réformes structurelles, intégration régionale et coopération internationale), et à la suite du Programme économique régional (PER), le cadre presqu’exclusif pour la mise en œuvre des actions rapides, vigoureuses et coordonnées pour la stabilisation du cadre macro-économique et une transformation structurelle profonde des économies de la sous-région.
C’est en ce moment la boussole structurelle de la CEMAC. Il en est de même du rapport attendu du président Obiang sur le fonctionnement des institutions de la CEMAC qui ont besoin de toilettage, ou encore la révision des modalités d’élection des députés communautaires au suffrage universel. En procédant ainsi comme le fait l’Union européenne, l’on aura certainement plus de démocratie communautaire, plus de légitimité pour ces élus, et donc une meilleure gouvernance de la CEMAC.
Les deux communautés économiques régionales continuent de s’ignorer et fonctionnent en vase clos. Ne doit-on pas désespérer de l’intégration en Afrique centrale ?
Beaucoup de choses restent encore à faire, mais les deux communautés ne s’ignorent pas et ne fonctionnent vraiment pas en vase clos comme on pourrait le penser. Je vous ai parlé plus haut de l’harmonisation qui a déjà été faite sur certains textes, politiques et programmes depuis 2019, y compris celle qui tient compte de l’avènement de la ZLECAf. Dans le domaine du marché commun par exemple, l’on peut citer l’harmonisation et l’uniformisation des règles d’origine, le certificat d’origine, dossier d’agrément au tarif préférentiel, le formulaire uniformisé pour la vérification de l’origine des produits, le schéma-type uniformisé relatif à la procédure d’agrément ; la création, l’organisation et le fonctionnement du Comité régional de facilitation des échanges en Afrique centrale ; la procédure d’obtention d’agrément sur les produits industriels au tarif préférentiel de l’Afrique centrale ; ou encore l’institution d’un comité régional sur l’origine en Afrique centrale
Que proposez-vous pour sortir l’Afrique centrale de l’ornière ?
L’intégration régionale est un processus, en plus de cela elle dépend largement à la fois des dynamiques souverainistes nationales et de la géopolitique mondiale. La seule volonté des Etats ne suffit pas à transformer par une baguette magique tous les objectifs en réalisations concrètes. Il n’y a pas de solution magique, il faut simplement combiner la volonté politique aux objectifs communautaires tout en anticipant sur les chocs exogènes qui ont été jusqu’ici à la base des grandes réformes que nous avons vécu en Afrique centrale ces deux dernières décennies.
Quel accueil votre ouvrage reçoit auprès des autorités en charge d’implémenter l’intégration en Afrique centrale ?
Je n’ai pas encore envisagé une présentation officielle de cet ouvrage, notamment auprès des autorités politiques et communautaires. Il est d’abord à vocation pédagogique. A chaque fois que je décide d’écrire un ouvrage (près d’une dizaine déjà) je pense d’abord à mes étudiants. C’est pour eux que j’écris. Ce sont les réponses à leurs questions dans l’amphi qui constituent la trame de tous mes ouvrages, même si certains peuvent y voir des outils d’aide à la décision. Le moment arrivera peut-être de présenter l’ouvrage au grand public en général et aux autorités en particulier. Question de temps également. A peine j’ai publié un livre que je me remets déjà à écrire un autre.
Propos recueillis par Thierry Ndong Owona