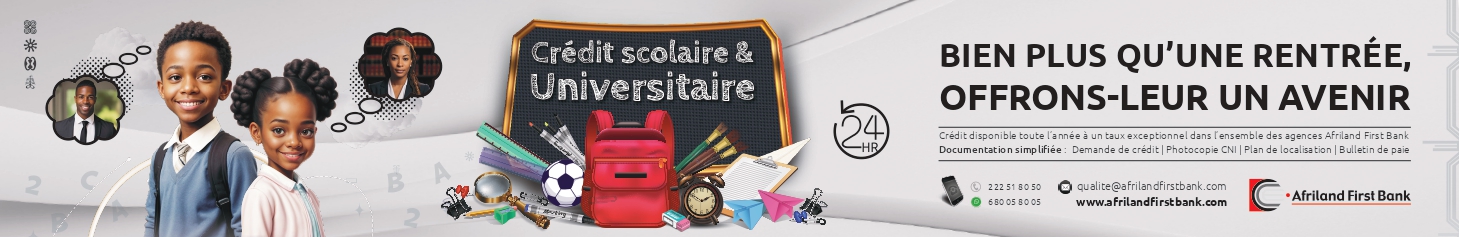Chez nous, comme chez les autres d’ailleurs, la presse est considérée comme un des lieux où non seulement se déroule le débat politique par l’échange d’arguments, mais aussi où se nouent les rapports de force, par la prise de position des différents acteurs.

Au Cameroun, le contexte politique aidant, nos médias n’en finissent plus de proposer une masse d’hommes dont les idées réagissent au même instant sur les plateaux. Seulement, s’il est commun de considérer que cela nourrit le débat sociopolitique, il est de plus compliqué de ne pas se poser la question de savoir si les plateaux radio et télé ne sont pas devenus un lieu où « quelque chose se passe ».
Prenons les choses par ce bout et commençons par observer qu’autour de certains sujets, les débats proposés par nos chaînes de radio et de télévision tournent en bataille d’experts. Bien loin des thèmes et des questions à l’ordre du jour, le jeu de la parole de nos agrégés se vit comme un soufflet de forge qui attise la moindre étincelle, pour en faire jaillir un immense incendie. Outre mesure, on ne saurait se surprendre de ce qui est finalement offert au public : des émissions engagées dans un processus de dénigrement mutuel dans un tohu-bohu d’attaques indirectes ou sous-entendues, toutes combinées parfois à des déclarations sentencieuses, à des invectives venimeuses et à un grand nombre d’erreurs de raisonnement. Et s’agissant de nos « Professeurs », il n’est pas sûr qu’on puisse considérer que leur langage lors des débats représente encore le langage d’expert.
Pendant de longues minutes, tout ce que disent nos experts et spécialistes opère au détriment de l’analyse critique des problèmes et des solutions. Ce phénomène est remarquable lorsque, consciemment ou non, ils décident de rentrer dans le débat par une question secondaire. Cette dérive n’exonère pas le public, qui est loin d’être une victime, puisqu’il nourrit, suscite ces involutions, participe aux émissions et les regarde…
De plus en plus flagrant, l’atypisme de l’image que renvoient nos agrégés affiche une trop grande incivilité et suggèrent une communication sans contrôle aucun. Dans ce vacarme, il s’ensuit un décentrage du débat à partir d’un dispositif qui trahit ouvertement déficits de cohérence. Et de fait, on plonge dans On n’est plus dans les fantasmes de quelques individus qui attendent que le modérateur gère les tours de parole dans le sens de leurs intérêts. À cause d’un paradoxe qui leur est propre, ils ne se contentent pas seulement de perdre du temps aux modérateurs. Ils sont aussi producteurs de trivialités.
Finalement, on se trompe en pensant que nos agrégés sont des personnes qui ont réussi à échapper aux tyrannies du sens commun ou aux a priori. On se rend bien compte que, d’eux-mêmes, ils donnent l’image négative d’intellectuels cassant ou verbeux, à l’aise dans les discours généraux et le tintamarre du buzz médiatique. La tentation est grande, alors, d’opposer savants et experts aux gens qui viennent décliner leurs parcours et profil sur les plateaux. A ce titre, il est lourd de signification de voir que cette spectacularisation portée par nos agrégés n’échappe pas aux ressorts du mauvais spectacle.
Jean René Mevé’a Amougou