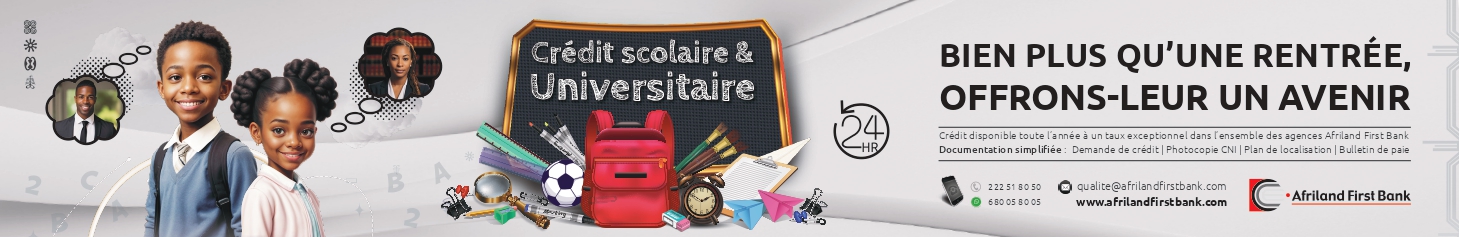Elles cultivent la terre, nourrissent les familles, gèrent les ressources naturelles. Pourtant, face aux bouleversements du climat, les femmes rurales de la la sous-région restent dans l’ombre.

Peu informées, peu formées, elles affrontent les sécheresses, les inondations et l’imprévisibilité des saisons sans les outils nécessaires pour comprendre ou s’adapter. Au regard de cet état de choses, quelques femmes rurales d’Afrique centrale crient en silence. Seule consolation, une ligne d’attaque animée par la CPTA et autres experts du développement durable. A suivre les explications des premières comme celles des seconds, la dépendance totale à la nature des femmes rurales est plus visible dans certains pays de la sous-région.
« Dans les campagnes du Cameroun, du Tchad, de la République Centrafricaine ou encore du Congo, les femmes sont les premières concernées par les conséquences des changements climatiques. Agriculture, élevage, collecte d’eau, de bois ou de produits forestiers : leur quotidien dépend directement des écosystèmes locaux. Mais quand la pluie se fait rare ou trop violente, quand les sols s’appauvrissent, quand les semences ne germent plus au bon moment, elles se retrouvent démunies », mentionne un rapport du PNUD publié en novembre 2023.
« Je ne comprends plus les saisons. Ce qui marchait il y a cinq ans ne marche plus aujourd’hui », témoigne Madeleine, une agricultrice venue de l’Est- Cameroun. Ce qui est enrobé dans ce propos est le manque criant d’information. « La majorité des femmes rurales n’ont pas accès à une éducation de base. Dans certaines régions, le taux d’alphabétisation féminine est inférieur à 30 %. Résultat : elles ne reçoivent pas, ou très peu, d’informations fiables sur les causes et les effets du changement climatique », déplore la CPTA.
Bien plus, « quand des campagnes de sensibilisation sont mises en place, elles sont souvent en français ou en anglais, peu adaptées aux langues locales. Les messages passent par les radios communautaires, mais touchent rarement les femmes, occupées par les tâches domestiques ou exclues des espaces publics ».
Dans cette ambiance d’explications scientifiques peu ou non accessibles, certaines femmes interprètent les phénomènes climatiques extrêmes à travers le prisme des croyances traditionnelles. « Pour nous, si la pluie ne vient pas, c’est que les ancêtres sont fâchés », confie une femme rurale venue du nord de la RDC.
Bien évidemment, de telles interprétations ne sont pas sans conséquences. « Elles retardent parfois la mise en place de solutions concrètes et créent une forme de résignation face aux catastrophes naturelles », crie Emmanuelle Yabanda.
Les oubliées des politiques climatiques
Autre facteur : l’exclusion systématique des femmes rurales des instances de décision. Rarement consultées, elles ne participent ni à l’élaboration des politiques agricoles, ni à celles liées à la gestion des ressources naturelles. « Le problème, ce n’est pas seulement qu’elles sont mal informées. C’est qu’on ne les écoute pas », dénonce une ONG locale basée au Tchad. Or, ces femmes disposent d’un savoir empirique précieux, issu de leur expérience du terrain. Sans leur implication, les stratégies d’adaptation peinent à atteindre les zones les plus vulnérables.
Jean-René Meva’a Amougou