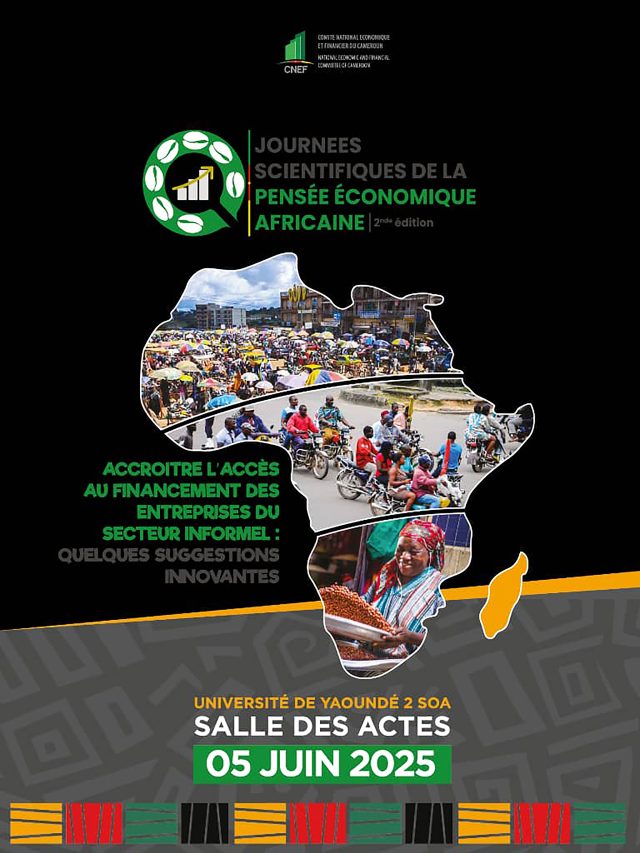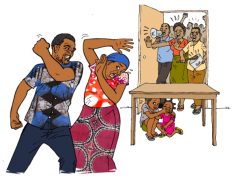Malgré une présence significative dans l’économie africaine, le secteur informel souffre des affres d’une considération préétablie en dehors des frontières du continent.
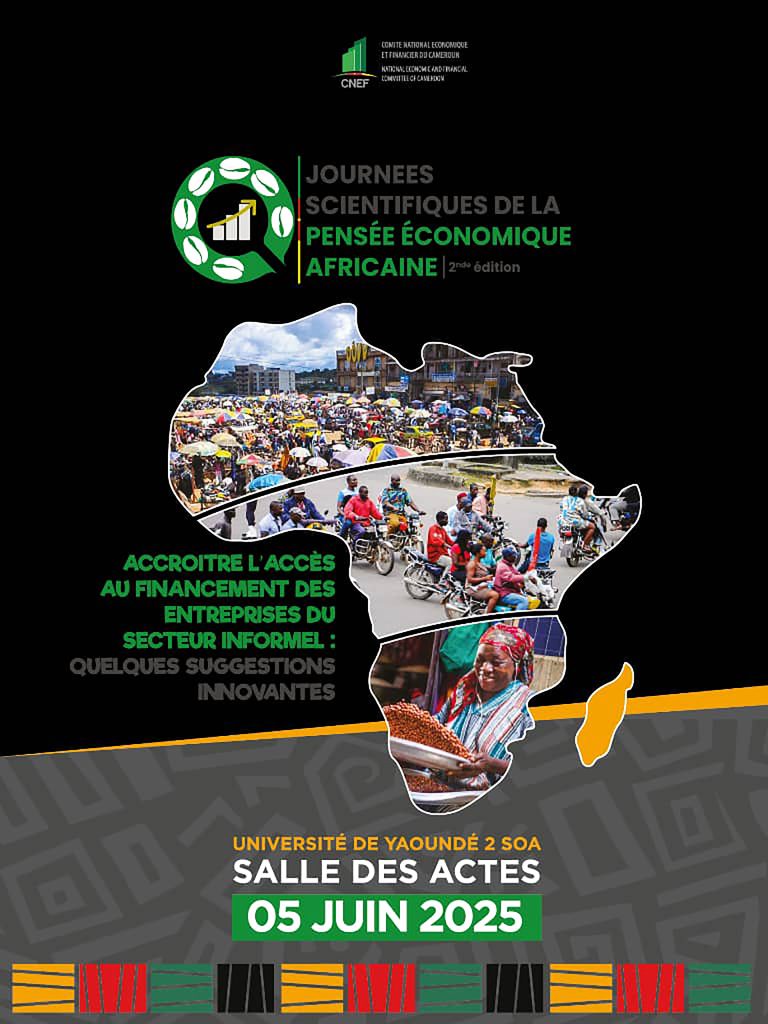
La 2e édition des Journées scientifiques de la pensée économique s’est tenue le 5 juin 2025 sous le thème « accroitre le financement des entreprises du secteur informel : quelques suggestions innovantes » a servi de plateforme pour la refondation des perceptions autour du secteur informel. A l’occurrence, en remettant en cause la « pensée occidentale » sur ce pan de l’économie africaine, selon la formule du Pr Pierre Nguimkeu; qui y trouve une « conception péjorative ». A force de mots, le professeur titulaire d’économie à la Georgia State University, aux Etats-Unis, déconstruit l’idée communément acceptée d’un ensemble d’opérations économiques fonctionnant en marge de la légalité tracée par des standards économique importés. Car pour le dire le discours prononcé à la salle des actes de l’Université de Yaoundé II énonce que «Pour parler de l’économie informelle, on y a 90 à 95% de la main d’œuvre. Mes collègues statisticiens vont vous dire que si quelque chose est vrai à 95% c’est ça la réalité; donc ce qui est tout juste 5% est statistiquement non significatif. Pourquoi donc prendre une économie qui domine à 95% comme quelque chose de mauvais. C’est tout simplement la façon dont nous avons fonctionné compte-tenu de notre structure sociale et nos contraintes», relève-t-il. La réalité évoquée, elle, fait référence à un total estimé de 12,8 millions de personnes employées dans l’informel au Cameroun à fin 2016, contre 1,8 millions de personnes relevant de l’économie formelle selon des données de l’Institut national de la statistique (INS) présentes dans le rapport «Changement de base des comptes nationaux en 2016: mesure de l’économie informelle». La situation en Afrique subsaharienne concerne 25 à 65% du PIB. Mais le pays de Paul Biya n’occupe que la 2e place au classement des Etats de l’Afrique centrale avec un secteur informel important. En tête de liste, le Gabon y frôle les 40 à 50% de son (PIB) d’après le Fonds monétaire internationale.
Les banques aux avant-postes des inégalités sociales
A la salle des actes de l’Université de Yaoundé II, la suite des réflexions a porté sur l’incidence des conceptions actuelles sur la transition des microstructures vers des formes d’entreprises émergentes. Sur le volet notamment des relations entre entrepreneurs et banques commerciales. «Lorsque vous vous présentez devant une banque pour demander un crédit pour lancer votre activité, la 1ere chose qu’on vous demande c’est un titre –foncier, une maison ou un bien à placer comme gage. Ça veut dire que ce marché sélectionne ceux qui sont déjà riches et non forcément ceux qui sont talentueux. Or, une économie devrait chercher ceux qui ont un potentiel de création d’entreprises et d’emplois. Ce n’est pas ce que font nos banques. Elles ne servent pas cet objectif-là. Elles se contentent de donner de l’argent à ceux qui en ont déjà et on se retrouve au final dans cette situation où la plupart des entreprises sont des microentreprises qui se débrouillent au bord des rues etc», explique l’homme des sciences. Les autres contraintes au financement du secteur informel évoquées portent sur le fait que les institutions financières considèrent les petites entreprises comme un risque, le coût élevé des crédits, la méfiance culturelle vis-à-vis des banques, entre autres.
Inégalités de revenus
Les restrictions d’accès au crédit auxquelles se butent des petits opérateurs économiques ne sont pas sans effet sur leur développement de l’entrepreneuriat au Cameroun et sur le continent. Elles en bloquent les avancées au moment même où les Etats en font un débouché afin d’enrayer le chômage au sein de leurs populations. Le tableau dépeint par le Pr Pierre Nguimkeu brosse la question des inégalités sur les revenus. «Si vous êtes extrêmement talentueux, vous allez prendre le temps qu’il faut et vous allez vendre les beignets, les arachides… pour accumuler le capital jusqu’à ce que le montant qui vous permet de réaliser votre rêve entrepreneurial soit atteint. Dans les simulations que j’ai faites par exemple au niveau du Cameroun, le temps moyen est de 7 ans. Si on compare donc cette progression avec celle des personnes talentueuse mais jouissant au départ d’une richesse, vous vous rendez compte que la deuxième catégorie va plus vite évoluer. De plus, ce manque de revenus contribue à la dégradation du bien-être social. Cela veut dire qui si vous étiez capable de créer votre entreprise à l’instant et d’avoir ainsi une source de revenus, vous êtes obligés d’attendre quelques années. Pendant ce temps vous êtes privés de revenus», explique-t-il, insistant sur le manque à gagner pour des économies en développement comme celles d’Afrique centrale.
Louise Nsana
La pensée Africaine Emerge
L’on est passé de simples velléités à des actes concrets en ce qui concerne l’émergence de la pensée africaine. Dans de nombreux domaines des sciences, les détenteurs du savoir mutualisent désormais leurs énergies pour trouver des solutions africaines aux problèmes du continent. Laissant ainsi à voir les défis suivant un recadrage conforme aux réalités et perceptions africaines. Les Journées scientifiques sur la pensée économique africaine du Comité national économique et financier du Cameroun (CNEF) s’inscrivent dans cette logique. Elles mettent en lumière les solutions proposées par des chercheurs africains sur les problématiques de l’heure. Parvenue à sa deuxième édition le 5 juin 2025, cette rencontre des universitaires, des responsables d’administration, de chancelleries, d’institutions, des banques commerciales et de la banque centrale, s’est penchée sur la question d’« accroitre le financement du secteur informel : quelques solutions innovantes ». Une question qui prend de l’importance au vu de la taille et de la contribution du secteur informel ainsi que de la persistance de la pauvreté et ses phénomènes connexes à savoir le sous-emploi et le chômage. Ce dernier quoiqu’en recul dans la sous-région Afrique centrale (10,8% en 2021 contre 9,8% en 2023), reste un défi pour la plupart des pays. Principalement au Gabon (20,3%) et en République du Congo (19,8%), au Cameroun (environ 5%) ; tandis que les pourcentages de chômage au Tchad sont inférieurs à 1%, selon des données ventilées par la Commission économique pour l’Afrique (CEA) dans son « Rapport sur l’état de la diversification économique en Afrique centrale».
Financement du secteur informel : l’aubaine des données technologiques
Celles-ci comportent des niches d’informations susceptibles de constituer l’aide la décision des banques en matière de crédit.
Face à un secteur informel inquantifiable et sans cesse en développement, les Etats africains multiplient des initiatives en vue d’en impulser la migration vers des activités légales dûment enregistrées et prospères. Seulement, le financement de ce secteur reste un défi permanent, qui empêche toute velléité d’éclosion ; et les procédures en ce domaine se sont davantage complexifiées avec la survenue de la crise sanitaire de Coronavirus. Cet évènement et les autres chocs mondiaux ont accru la méfiance des établissements de crédit. Alors même que dès le départ, celles-ci n’ont eu de cesse de considérer les entreprises du secteur informel comme un risque. Cela du fait de l’incapacité des promoteurs à fournir toutes les garanties de remboursement. La Banque des Etats de l’Afrique centrale (Beac) donne un panoramique large de la situation dans son rapport sur les taux débiteurs au 2e trimestre 2024, la Banque centrale indique qu’entre le 2e trimestre de 2023 et celui de 2024 les grandes entreprises ont capté 65, 14% des nouveaux crédits accordées par les banques en Afrique centrale. Soit 1712,4 milliards de FCFA. La part des PME n’a représenté que 18,68%, tandis que les créances aux particuliers ont reculé de 17,24 % pour se fixer à 278,4 milliards, contre 336,4 milliards un an auparavant.
De l’analyse du Pr Pierre Nguimkeng, cette méfiance qui repose aussi en grande partie sur l’asymétrie d’information entre la banque et l’emprunteur; peut trouver solution grâce à l’exploitation des données individuelles d’utilisation des services financiers mobiles. Lequel mode transactionnel a tourné autour de 1,6 milliards entre 2018 et 2022. Le tout pour une valeur 17 207,6 milliards de FCFA générée par quelques 10 320 632 comptes actifs, selon le Rapport sur le développement de l’économie numérique produit en 2023 par le ministère de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du territoire. «Aujourd’hui les gens font toutes sortes de transaction mobile money et ensuite avec les nouvelles technologies, on sait où vous trouver à tout moment de la journée même quand votre téléphone est éteint. Donc on peut retracer votre trajectoire, vos déplacements et toutes vos transactions financières même si vous êtes un commerçant informel. On peut ainsi résoudre le problème d’accès à l’information pour comprendre à qui on a à faire, quel type d’activité la personne fait, où est-ce que cette personne s’approvisionne, etc. Et donc s’il y a un partenariat public-privé, avec les banques et les opérateurs de télécoms, il est possible de créer un score de crédit pour chaque entrepreneur. Ainsi si un entrepreneur lamda sollicite un crédit par exemple de 2 millions de FCFA, on peut savoir à partir de son historique de transaction quelles sont ses capacités remboursement», explique l’enseignant d’université. Le Pr Pierre Nguimkeng selon sa formule, y trouve également une solution en faveur de la réduction des exigences de garanties. Il appelle par ailleurs à l’adoption de politiques d’encadrement des garanties.
Les tontines malgré tout
La convergence des vues obtenues à l’Université de Yaoundé a permis de transcender le simple cadre des innovations à entreprendre pour améliorer l’accès au financement du secteur informel ; pour questionner les niveaux de confiance des populations vis-à-vis des institutions de crédit. «Quand vous regardez les taux d’intérêt dans les tontines, ils sont extrêmement élevés. Surtout les tontines où on achète l’argent. C’est-à-dire que vous voulez faire un prêt de 10 millions de FCFA, vous donnez d’abord 2 ou 3 millions pour acheter et ça ne compte pas dans les intérêts. Mais pourquoi ça convient aux petits entrepreneurs malgré tout? C’est parce que premièrement, ils sont confiants. Ils passent du temps avec des gens qu’ils connaissent. Deuxièmement à cause de la rapidité d’accès. On arrive à la réunion et le soir tu rentres avec ton argent. On peut donc réfléchir à comment rendre la banque plus proche, plus contextuelle par rapport à nos propres réalités», souligne le Pr Pierre Nguimkeu. Pour l’heure, la source de l’auto-financement reste la voie de financement la plus courue, avec un taux 70% des entrepreneurs concernés.
Louise Nsana